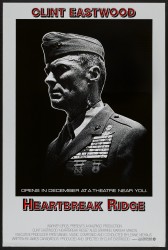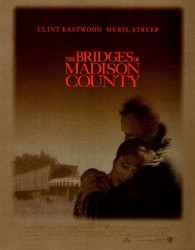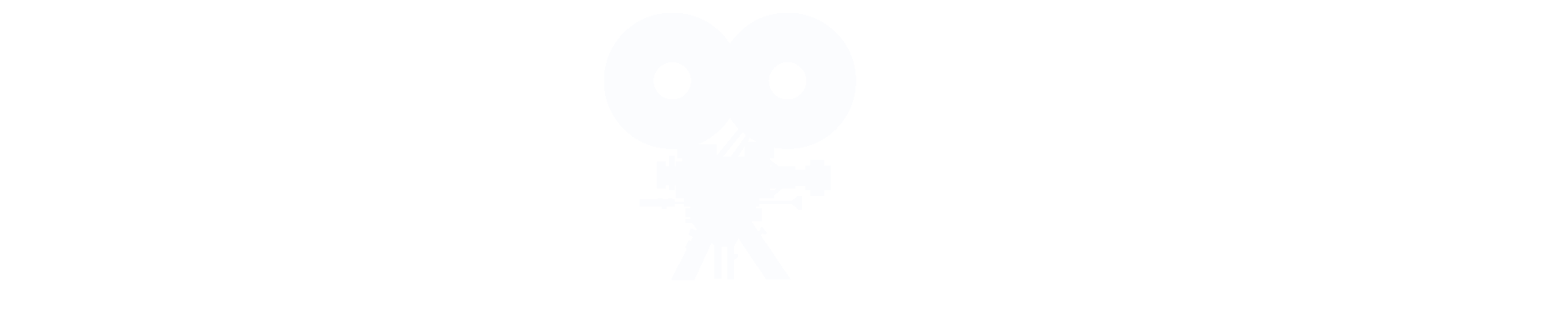Séance de rattrapage, deuxième ! Le principe reste le même : chaque mois, Daily Movies choisit un réalisateur et demande à ses rédacteurs de « rattraper » un film de ce dernier qu’ils n’ont pas encore vu. Nous entendons ainsi proposer une perspective multiple sur les filmographies de certains grands noms du 7ème art. Après une première Séance de rattrapage consacrée à Pedro Almodóvar, c’est sans hésitation que nous avons jeté notre dévolu sur Clint Eastwood pour le deuxième numéro de cette nouvelle rubrique placée sous le signe de la découverte.
Si l’Américain a « officiellement » mis un terme à sa carrière d’acteur en 2008 après son rôle dans le crépusculaire Gran Torino (avant de revenir une 67ème et dernière fois devant la caméra dans Une nouvelle chance en 2012), rien ne semble pouvoir arrêter sa carrière de réalisateur. À 84 ans, Eastwood vient de sortir son 34ème film, American Sniper (six fois nommé aux Oscars et d’ores et déjà le plus gros succès au box-office américain du réalisateur avec près de 300 millions de dollars de recettes) nous rappelant que nous pouvons toujours compter sur lui. Nos rédacteurs se sont ainsi plongés dans une des filmographies les plus impressionnantes du cinéma américain pour y découvrir une nouvelle facette de cet homme protéiforme.
Les six textes que nous vous proposons ci-dessous témoignent bien de la diversité qui marque la carrière de Clint Eastwood ; du « cowboy sans nom » au flic macho et radical en passant par le sergent putassier, le photographe romantique et le militaire ou le cowboy repenti ; les films et les rôles de Clint en ont troublé et froissé plus d’un, à l’image de sa vie et de ses engagements politiques. Voici donc quelques mots de nos rédacteurs sur cet homme retors à la carrière complexe, qui n’a cessé de déjouer les clichés et de maltraiter le politiquement correct. En un homme : une légende. Peut-être même la dernière encore en activité.
The Eiger Sanction, 1975
Il m’est presque impossible de me souvenir par quel film j’ai empoigné la filmographie d’Eastwood. Peut-être était-ce True Crime, un de ces films dans lesquels Clint s’empêtre dans les bons sentiments. Autant dire que j’aurais pu partir sur de meilleures bases. Mais pas de quoi me décourager. Et si le réalisateur est périodiquement retombé dans le tire-larmes facile (Million Dollar Baby, l’insupportable Changeling, Invictus…) il demeure un des cinéastes qui m’a le moins souvent déçu.
J’avoue avoir un faible pour les grandes gueules qui ne pensent pas comme tout le monde et qui osent le dire. Et dans le genre semeur de troubles et agitateur réactionnaire, Clint est une icône. En découvrant les personnages de l’inspecteur Harry (que Clint a non seulement joué mais également pleinement assumé en réalisant le quatrième volet de la série), du vengeur des Hautes Plaines ou encore du sergent Highway qui jure autant qu’il ne respire, j’ai bu du petit lait. Le réalisateur est rapidement devenu pour moi le dernier représentant d’une époque révolue et regrettée; le seul et unique survivant du naufrage de la virilité du siècle passé. Un homme qui jure, qui crache, qui rentre dans le lard, qui cogne mais aussi un homme qui pense et qui se questionne comme l’ont prouvé les deux magnifiques regards lancés dans le rétroviseur de sa carrière que sont Unforgiven et Gran Torino qui proposent tous deux une réflexion sur ses personnages à la gâchette facile.
La poésie et le romantisme de A Perfect World et The Bridges of Madison County m’ont également touché. J’ai été amusé par Space Cowboys et j’ai salué l’honnêteté de la démarche de son diptyque sur la Guerre du Pacifique. J’avoue enfin avoir été ému par la sensibilité à fleur de peau de Hereafter, détesté par pratiquement l’entier de mes confrères. En bref, Clint est un réalisateur précieux à mes yeux, un réalisateur qui dérange de par sa complexité – à l’image du personnage de Sean Penn dans l’excellent Mystic River – et qui force à se questionner sur la nature humaine en n’hésitant pas à filmer nos parts d’ombre et ses propres démons.
J’ai donc profité de cette deuxième « Séance de rattrapage », pour visionner le plus helvétique des films de Clint Eastwood : The Eiger Sanction. Pour sa quatrième réalisation, Clint se donne le rôle de Jonathan Hemlock (après le refus de Paul Newman), un collectionneur et professeur d’art également ex-agent secret officiant pour le « C2 », une sombre organisation gouvernementale menée par un certain Monsieur Dragon, un ancien nazi albinos qui vit dans l’obscurité sous transfusion sanguine permanente et qui somme ses agent d’effectuer des « sanctions » – comprenez des meurtres. Alors qu’il pensait ne plus avoir à tuer, Hemlock est contacté par Monsieur Dragon qui lui demande de « sanctionner » les deux assassins d’un agent du « C2 » et le menace de dénoncer sa collection de tableaux acquis grâce aux primes de ses précédentes « sanctions » à l’Internal Revenue Service. De peur de perdre sa collection, Hemlock accepte le contrat.
Dit comme ça, le synopsis de The Eiger Sanction semble annoncer une grosse série B, un ersatz de James Bond au rabais. Et il est vrai que la première partie du film nous laisse présager le pire ; on sent bien que ce n’est pas l’enquête à proprement parler qui a motivé Eastwood à adapter le roman homonyme de Trevanian. Non, si le réalisateur a souhaité mettre en scène ce roman de gare, c’est essentiellement parce son intrigue bascule rapidement dans l’aventure sportive. En effet, la deuxième cible de Hemlock s’avère être un alpiniste qui participera à l’ascension de la mythique et redoutable face nord de l’Eiger. Sans que l’on comprenne vraiment pourquoi, Hemlock devra s’inscrire à la course pour honorer son contrat. Mais avant d’aller affronter l’Ogre des Alpes bernoises, l’agent va devoir s’entrainer dans les montagnes de l’Ouest américain.
Hemlock est certainement le rôle le plus grossièrement macho et homophobe de la carrière de Clint
Vous l’aurez compris, le scénario de The Eiger Sanction n’est qu’un prétexte à peine camouflé pour s’offrir quelques belles séquences d’exploit sportif. Si l’exposition et les parties mettant en scène Monsieur Dragon prêtent à sourire, les scènes d’entrainement filmées dans le parc national de Zion et la partie finale en Suisse réservent leur lot de jolies surprises. Avec un brin de complaisance, Clint Eastwood multiplie les plans d’hélicoptères afin de prouver au spectateur que c’est bien lui et non une doublure qui escalade le fameux Totem Pole de Monument Valley et l’Eiger. Ces nombreux plans extrêmement périlleux confèrent une certaine ampleur à la mise en scène du réalisateur, nettement plus à l’aise dans cet exercice que dans les séquences d’ « espionnage ».
L’écriture des personnages vaut celle de l’intrigue. Hemlock est certainement le rôle le plus grossièrement macho et homophobe de la carrière de Clint ; claquant les fesses de chaque femme passant à proximité, insultant ses étudiantes qui lui font du gringue et ses rivaux efféminés, son comportement et les dialogues ne laissent strictement aucune place à la finesse. La palme revient à cette idée de faire courir une belle Indienne devant lui pour le motiver à s’entrainer. Lorsque Hemlock n’a plus de force, il suffit à la belle native de se mettre seins nus pour que ce dernier escalade une ultime colline.
De ce film étrangement scindé en deux parties, je garderai donc un souvenir amusé mais mitigé. En effet, force est de constater qu’après Play Misty for Me, High Plains Drifter et Breezy, The Eiger Sanction marque une première baisse de régime dans la carrière du cinéaste. Mais son outrance, son ascension de l’Eiger remarquablement filmée et la très belle musique composée par John Williams valent à elles seules le détour. Sans oublier l’histoire mouvementée de son tournage, qui coûta la vie à David Knowles, une doublure également photographe sur le tournage.
[Thomas Gerber]
Heartbreak Ridge, 1986
Biberonné aux films de Clint Eastwood durant mon adolescence, je me suis toujours promis de voir tous ses films. Unforgiven m’a transmis l’amour du western, tandis que A Perfect World et Mystic River m’ont profondément ému. On oublie souvent que le grand Clint n’a pas débuté sa carrière en tant que réalisateur dans les années 1990 mais dans les années 1970 déjà. C’est en découvrant son chef-d’œuvre High Plains Drifter que mon amour pour son cinéma a encore gagné en intensité. Un cinéma classique, un cinéma de valeurs. J’ai beau avoir eu quelques réserves sur Hereafter ou Invictus, c’est avec une curiosité non feinte que je découvris ce Heartbreak Ridge, datant de 1986.
La première scène donne le ton : Eastwood choisit le noir et blanc et les images d’archives de la Guerre de Corée pour ancrer son récit dans une réalité tangible. Puis, de retour à la fiction, la caméra pénètre dans une prison, accompagnée d’une voix off que l’on devine être celle de l’acteur-réalisateur. S’octroyant le rôle de Tom Highway, médaillé de l’armée adepte de la bouteille, il incarne avec justesse ce personnage nostalgique de ses exploits passés. Dès les premiers instants Highway use de punchlines, Eastwood reprenant le modèle de dur à grande gueule popularisé par Dirty Harry. L’apparition de son personnage marque également le passage à la couleur, contraste entre les images d’archives très dures montrées en noir et blanc et son personnage qui provoque l’hilarité à chaque réplique. C’est vraiment dans cette ambiance potache propre aux années 1980 que le film baigne.
Tom Highway hérite de la lourde tâche de former un bataillon de jeunes Marines mous du genou à devenir des durs à cuire. Mise à part la séquence finale, aucune scène d’action ou de guerre n’est présente dans le film. Le cœur de celui-ci se situe vraiment dans le rapport de Highway avec son bataillon et son ex-femme, son vécu durant la guerre et son passif qui vient parasiter sa capacité à interagir avec autrui. On retrouvera cette confrontation « ancienne génération / nouvelle génération » dans le reste de sa filmographie (notamment Gran Torino).
C’est ce contraste générationnel qui apporte toute l’émotion nécessaire pour en faire un film marquant dans la filmographie de Clint Eastwood. Voir Highway lire des magasines féminins pour comprendre comment se rabibocher avec son ex-femme a quelque chose de touchant et profondément humain qui détonne avec la dureté apparente du personnage. Tout le film se construit sur cette notion de contrastes, avant de s’achever par un transfert générationnel entre Highway et l’un de ses subalternes qui décide de s’engager définitivement dans l’armée suite à cette formation musclée.
l’un des derniers représentants d’un cinéma classique aux valeurs surannées
De cette manière, les valeurs « old school » que défend Highway (et par extension Eastwood) ont trouvé écho dans cette jeune génération. Un personnage « dinosaure » comme le réalisateur les affectionne tant. Un peu à l’image de son cinéma, Eastwood étant l’un des derniers représentants d’un cinéma classique aux valeurs surannées. Mais à 84 ans et face au succès phénoménal de son récent American Sniper (quelques 300 millions de dollars au box-office pour un budget de 58 millions), Clint Eastwood semble, comme Tom Highway, avoir trouvé un écho dans les nouvelles générations. La boucle est bouclée.
[Nathanaël Stoeri]
The Bridges of Madison County, 1996
Contrairement à beaucoup de cinéphiles, je n’ai pas grandi avec l’image symbolique de Clint Eastwood en cowboy nonchalant, habillé de son poncho et fumant son cigarillo. Si ma mémoire ne me joue pas un tour, la première fois où je fus confronté à cette figure du cinéma américain fut lorsque je découvris Million Dollar Baby au cinéma, au début des années 2000. Depuis, je pus rattraper quelques-unes de mes lacunes dans sa filmographie, que je tente encore de combler aujourd’hui.
Pour la deuxième édition de cette rubrique, mon choix s’est porté sur The Bridges of Madison County (Sur la route de Madison, dans sa version française), pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le film a une jolie réputation et qu’il m’a toujours fait de l’œil ; secondement, de manière plus affective, parce que je sais qu’il plaît beaucoup à un membre de ma famille. Quoiqu’il en soit, c’est avec une certaine ferveur que j’attaque ce drame de 2h15 qui raconte la brève mais intense rencontre entre Francesca Johnson (Meryl Streep), une femme au foyer, et Robert Kincaid (Clint himself), un photographe travaillant pour National Geographic.
la première séquence où l’actrice est présentée sous les traits de Francesca éblouit par la justesse du jeu de Streep
De prime abord, ce qui frappe le plus dans le film, c’est la performance de Meryl Streep. Après la scène d’introduction du récit-cadre (le film est narré en flashback), la première séquence où l’actrice est présentée sous les traits de Francesca éblouit par la justesse du jeu de Streep. Méconnaissable, cette dernière arbore un léger accent italien qui dénote les origines du personnage, celui d’une mère excédée par son rôle de… mère. Lors du repas familial auquel le spectateur est convié, l’on ressent très vite le conflit intérieur qui attriste Francesca, délaissée par son mari et dont les enfants sont peu reconnaissants envers le travail qu’elle fournit. En peu de dialogues, l’actrice parvient à porter en elle le chagrin du personnage, qu’elle exprime à travers un jeu de regards fuyant, comme si elle cherchait à s’extirper de cette vie qui ne lui convient plus tout à fait.
Sa rencontre avec Robert bouleverse inévitablement ses idéaux et ses perspectives ; un véritable dilemme cornélien qui ne tarde pas à structurer le film. Face à Meryl Streep, Clint Eastwood dégage suffisamment de charme et de masculinité pour rendre les sensations de la protagoniste crédibles et tangibles pour le spectateur. En tant que metteur en scène, il semble à l’étroit dans la demeure des Johnson pour dépeindre cette idylle naissante et tardive. Ce sera lors des séquences au pont de Madison que la caméra du réalisateur proposera les plus belles images de ces personnages, à travers un sens du cadrage ahurissant et une splendide photographie, gorgée de soleil.
Si la dimension dramatique tend à s’éterniser sur la dernière partie, elle s’avère néanmoins bouleversante lors des séquences-clés, la douleur de Francesca s’avérant totalement communicative. En revanche, les correspondances avec le temps présent (le récit-cadre) et les enfants de la protagoniste lisant les journaux de celle-ci peinent à convaincre et semblent un peu trop forcées. Était-il vraiment nécessaire de corréler les choix de vie de Francesca aussi lourdement avec la situation de chaque enfant? Durant ces passages – notamment sur la dernière partie –, l’apparente simplicité du drame affiche trop visiblement ses mécanismes lacrymaux, ce qui amenuise l’empathie ressentie par les spectateurs.
Près de vingt ans après avoir été réalisé, The Bridges of Madison County fascine par la justesse de ton avec laquelle Eastwood aborde sa protagoniste. À ce propos, la perspective féministe du film détonne vis-à-vis des penchants machistes dont le cinéaste avait pu faire preuve jusque-là au long de sa carrière. Il livre ici un film touchant, profondément humain, qui jure avec ses récentes réalisations, qui apparaissent plus froides et plus calculées.
[Loïc Valceschini]
True Crime, 1999
Il y a des films qui m’ont toujours intrigué dans la filmographie de Clint Eastwood réalisateur : les « petites œuvres » perdues entre les grands chefs-d’œuvre mondialement reconnus. Des films dont on parle peu, éclipsés par le voisinage d’une grosse machine à Oscars. C’est en visionnant par hasard et coup sur coup Créance de Sang et Les Pleins Pouvoirs que j’ai découvert l’existence de ces réalisations certes mineures dans une telle carrière mais non dénuées d’intérêt. Cachés entre Impitoyable, Sur la Route de Madison et Mystic River, je remarquais enfin ces petits films de genre (souvent des thrillers), pas formidables mais simplement bien troussés. Jugé Coupable semblant en faire partie, je m’étais promis de le découvrir un jour ou l’autre. Cette « Séance de rattrapage » était l’occasion ou jamais.
Eastwood y incarne Steve Everett, vieux journaliste porté sur l’alcool, coureur de jupons et père absent. Sur la sellette depuis une bourde qui aurait dû lui coûter son poste, il ne se maintient à sa place que grâce à son exceptionnel « flair ». Suite à un drame dont il est en partie responsable, il est chargé de remplacer une collègue pour interviewer un condamné à mort quelques heures avant son exécution. Mais tandis qu’il prépare son entrevue, son intuition, qui ne l’a que rarement trompé, lui dit que Frank Beechum, père de famille noir au passé trouble, n’a pas commis le meurtre dont on l’accuse. Ce qui n’était qu’un simple papier devient alors pour Everett une course contre la montre pour prouver l’innocence de Beechum avant l’heure fatidique, et par-là trouver peut-être le moyen de racheter ses propres erreurs passées.
Un excellent thriller doublé d’un vrai drame, le tout mâtiné de la touche cynique propre à son auteur
C’est encore un bon petit film que j’ai découvert avec Jugé Coupable. Un excellent thriller doublé d’un vrai drame, le tout mâtiné de la touche cynique propre à son auteur. Indéniablement, Eastwood sait créer des personnages, à commencer par le héros qu’il incarne (son habituel rôle de grande gueule désabusée), à qui il offre un background consistant et une vraie épaisseur. L’identification fonctionne immédiatement, et le film nous embarque alors sans problème dans une intrigue plutôt efficace, qui parvient à jouer habilement avec nos nerfs grâce à l’infaillible argument du compte-à-rebours. A ce titre, la résolution est particulièrement roublarde, masquant soudain les actions d’Everett et rendant de fait les dernières minutes extrêmement tendues.
Au-delà de son efficacité, le film procure également une réelle émotion. Si le sous-texte sur le racisme reste finalement assez réduit, le récit touche juste en confrontant régulièrement notre compréhension de la triste réalité qui se déroule devant nos yeux au point de vue d’enfants : la fille d’Everett puis celle de Beechum. Par leurs envies dérisoires et leurs questionnements très terre-à-terre, les deux fillettes mettent ainsi les adultes face à l’absurdité et la violence de leur monde.
Sans aucun doute loin d’être à la mesure des grands chefs-d’œuvre de Clint Eastwood, Jugé Coupable reste une œuvre propre et sympathique, un divertissement qui remplit parfaitement son office, soit un visionnage hautement recommandable pour qui aurait apprécié Les Pleins Pouvoirs et Créance de Sang.
[Thibaud Ducret]
Flags of Our Fathers & Letters from Iwo Jima, 2006
Clint Eastwood, pour moi, c’est d’abord Blondin (ah, la VF!) dans la fameuse trilogie leonienne, puis ensuite Frank Horrigan dans In the Line of Fire (avec Malkovich en bad guy décompensé) et enfin l’incroyable Gunny Highway de Heartbreak Ridge… tous des films qui passaient à répétitions sur la chaîne câblée RTL9, à qui je dois une bonne partie de ma cinéphilie adolescente, que ce soit en matière de chefs-d’oeuvre ou de nanars.
Puis, grâce à la collection « Westerns de Légende » (en vente chez votre marchand de journaux), je découvre Unforgiven, un western ultime que je crois alors réalisé par Sergio Leone… Je ne comprends pas à l’époque qu’un acteur puisse être à la fois devant et derrière la caméra. C’est physiquement impossible ! Mais les années à venir lèveront le voile sur ces méthodes de tournage et j’apprendrai aussi plus tard que Heartbreak Ridge est réalisé par le même homme… comme quoi.
Clint Eastwood est donc devenu réalisateur. Quelle drôle d’idée ! Je ne suis alors ses films que sporadiquement, car je découvre d’autres pans du cinéma mondial, qui me passionnent bien plus et me prennent plus de temps. Et surtout que du peu de films que je vois d’Eastwood, certains m’horripilent au plus haut point (Million Dollar Baby), alors que je vais en voir d’autres plusieurs fois en salles (Gran Torino). Blondin est donc capable du meilleur comme du pire et la suite de sa filmographie allait faire de cette théorie un état de fait.
Ce qui m’amène à un des meilleurs exemples de la dualité qualitative eastwoodienne : le diptyque Flags of Our Fathers/Letters from Iwo Jima.
Présenter une bataille marquante de la Guerre du Pacifique, en adoptant tour à tour le point de vue des deux belligérants, tout en étant critique envers le fonctionnement interne de chaque camp : voilà un concept louable et ambitieux ! D’autant plus venant d’un réalisateur connu pour son patriotisme. Avant donc même de livrer son produit final, Eastwood place la barre très haute, mais n’arrive malheureusement pas à la passer, s’arrêtant en plein vol. Car s’il réussit son pari du double point de vue, il ne réussit pas à renouveler le film de guerre et tombe ainsi dans les poncifs du genre, s’y enlisant même parfois…
Eastwood est capable du meilleur comme du pire
Que dire de Flags of our Fathers ? Si ce n’est que son idée de départ est intéressante, mais qu’elle tombe très vite dans une analyse trop banale et trop évidente. On comprend rapidement que le film ne parle pas vraiment de la bataille, mais plutôt du fameux drapeau planté au sommet du Mont Suribachi, de la récupération médiatique et mensongère de cet exploit par le gouvernement américain et surtout des états d’âmes des soldats choisis pour parader devant les foules, à la place des vrais héros morts au combat, eux. On a donc ici un terreau parfait et propice à l’analyse critique, psychologique et nuancée d’un haut fait historique. Mais… Eastwood préfère ne pas se mouiller et au lieu de nous livrer un brûlot contestataire et inspiré, qui m’aurait personnellement réjoui, préfère tomber dans la mièvrerie, dans le copié-collé et dans une ode au soldat américain, certes tragique, mais sans relief. Le sujet est justifié et justifiable, mais l’approche est trop sage, trop lisse et surtout déjà vue.
Changement de programme pour Letters from Iwo Jima ! Première différence de taille avec Flags of our Fathers : toute l’action se situe avant et pendant la bataille. L’évolution narrative et la construction des personnages sont ainsi bien mieux maîtrisées et surtout plus nuancées et crédibles. L’empathie fonctionne à merveille, aidée par une atmosphère bien plus lourde et grave, correspondant plus à l’ambition première d’Eastwood : montrer l’absurdité de la guerre. Deuxième différence : pas (ou très peu) de patriotisme. Le recul pris vis-à-vis de la situation, des principes souvent extrêmes de la culture militaire nipponne et de l’abandon des forces en présence par le gouvernement japonais lui-même force le respect et nous offre ainsi une analyse passionnante et surtout multiple, puisqu’elle s’attarde sur chaque réaction comportementale, aussi différente soit-elle des autres, au sein d’une même armée.
Eastwood ne réussit donc qu’à moitié son pari et nous livre un diptyque bancal, mais qui a l’avantage de commencer par le pire et de finir par le meilleur. Je me demande même si le fait qu’il traite d’une culture différente de la sienne n’aurait pas poussé le cinéaste à être plus travailleur et engagé sur Letters from Iwo Jima, tout en laissant ses acquis guider Flags of our Fathers, à son propre détriment.
Ce diptyque aux promesses ambitieuses ne m’a donc pas fait changer d’avis sur le cinéma de Clint Eastwood et a au contraire confirmé mon sentiment : Eastwood est capable du meilleur comme du pire. Blondin, lui, n’a toujours été capable que du meilleur. Mais bon, c’était mieux avant, non ?
[Florian Poupelin]
Changeling, 2008
En m’inscrivant à cette « Séance de rattrapage », je ne me doutais point que j’allais découvrir que ce grand cowboy sans nom, le cigare vissé au bec et le poncho bien ajusté sur les épaules était peut-être à l’origine de mon insatiable appétit pour le cinéma. Donc cette chronique, excusez-moi d’avance, va un peu tourner autour de mon nombril avant d’exposer celui de CLINT EASTWOOD. Je connais son nom maintenant, sais très bien qu’il n’est pas qu’un garçon-vacher ou un policier intrépide mais ça ne m’était pas venu instantanément. Il m’a d’abord fallu, de retour victorieux de mes duels de cours d’école, accepter quelques incongruités. Comme le fait qu’en plus de mourir pendu à des cordes ou faire creuser des tombes à ses ennemis dans le Far West leonien, « Le Blondin » s’évadait aussi d’Alcatraz, défouraillait la racaille, hot-dog à la main, dans les rues de Frisco et surtout, s’asseyait parfois derrière la caméra. L’illumination est peut-être venue de A Perfect World, qui me laissa, du haut de mes treize ans, particulièrement perturbé. Dirty Harry avait donc aussi de belles histoires à me raconter. « Belles » sonne un peu faux avec le recul mais c’était une manière de dire « déchirant » ou « puissant », à l’époque où je n’avais pas à choisir les mots justes, précis et convaincants, pour parler d’un film.
Je commençais tout simplement à découvrir que mes longues semaines sur les bancs d’école étaient bien moins trépidantes que mes trop courtes heures dans les salles obscures. « Obscures » justement, sombres aussi, comme le film du cinéaste que j’avais récemment découvert et qui ne m’offrira plus, pendant plusieurs années, que de divertissants thrillers ou des mélodrames bien chargés, certes efficaces mais loin des drames désespérés qui allaient venir : Mystic River et Million Dollar Baby, découverts au cinéma et à l’âge qui convenait. Tout m’y plaît : l’âpreté des sujets, la complexité des personnages et la morale ambiguë. La noirceur se ressent jusque dans l’image superbe de Tom Stern, le directeur photo, ici à son apogée, le plus plébiscité par le cinéaste à cette époque et jusqu’à aujourd’hui. Leur maîtrise commune se retrouve moins dans Flags of Our Fathers (leur collaboration suivante) mais éclate dans Letters from Iwo Jima. Puis il y a eu Changeling (sur lequel je vais donc logiquement et obligeamment consacrer le paragraphe suivant), Gran Torino, Invictus, Hereafter, J.Edgar, Jersey Boys et maintenant American Sniper. Une multitude de bons films mais qui ne me touchent pas autant que ceux que le grand Clint réalisa au milieu des années 2000. Alors que l’animal, rappelons-le, avançait déjà gaiement vers ses 80 printemps.
Je m’apprête donc à découvrir l’objet de ma contribution à cette rubrique : Changeling. Ma grande lacune « eastwoodienne » et une importante frustration personnelle, bientôt disparue, que je range parmi mes autres insubordinations de cinéphile populaire. (L’homme que vous lisez n’a jamais vu Star Wars IV, V et VI, par exemple…).
Le film alors ? Dès les premières secondes, il annonce la couleur, ou plutôt son absence justement, lors d’un premier plan-séquence débutant en noir-blanc pour se terminer en couleurs. On est bien dans un film d’époque, classique, qui reconstitue scolairement le Los Angeles des années 1930, avec ses voitures bien polishées et ses costumes trop propres. Cette entrée en matière semble crier tout haut que le réalisateur a consenti à la couleur pour des raisons commerciales évidentes mais que son intuition première avait été le monochrome. Sur cette déception première et alors que le récit commence à montrer ses premières aspérités, je laisse tomber mon carnet de notes et me laisse emporter par le film. J’ai toujours préféré l’émotion à l’analyse et suis d’abord, et j’espère encore, cet enfant béat devant les grands héros du Far West plutôt que le spectateur critique gribouillant ses futiles réflexions, rédigeant ses rapports et distribuant ses étoiles au gré des humeurs.
Quand Clint Eastwood n’est pas excellent, il est juste très bon.
La magie a opéré, la force de l’histoire et l’efficacité avec laquelle elle est contée par le cinéaste m’ont vite conquis. Il faut dire qu’il était peu probable que je ne m’attache pas à cet invraisemblable fait divers qui en dit long sur les basses besognes de la police de la cité des anges et qui sévissait à cette tumultueuse époque. Le cinéma m’avait familiarisé avec les malfrats qu’avait fait naître la prohibition et je découvre ici que les méthodes des forces de l’ordre étaient encore plus tordues et sournoises. Si je me doutais que la corruption était courante, je n’avais pas imaginé qu’on pouvait aller jusqu’à donner officiellement à la mère d’un enfant disparu, un « fils » de remplacement et l’obliger à se taire pour redorer le blason d’une institution d’État. C’est donc ma confiance vis-à-vis du pouvoir de dénonciation du cinéma qui est ici directement confortée. De plus, en termes de suspense et de construction dramaturgique, le film est un exemple. Le casting est excellent. Angelina Jolie, qu’on n’attendait sûrement pas à l’époque dans un rôle si intense, prouve sa légitimité d’actrice dramatique et les gueules choisies pour les seconds rôles sont parfaites.
C’est un peu comme avec tous les grands cinéastes. Je reconnais le génie, déplore un certain professionnalisme mais ne peux m’empêcher d’être conquis, tant le résultat surpasse sobrement la moyenne. Quand Clint Eastwood n’est pas excellent, il est juste très bon.
[Etienne Rey]