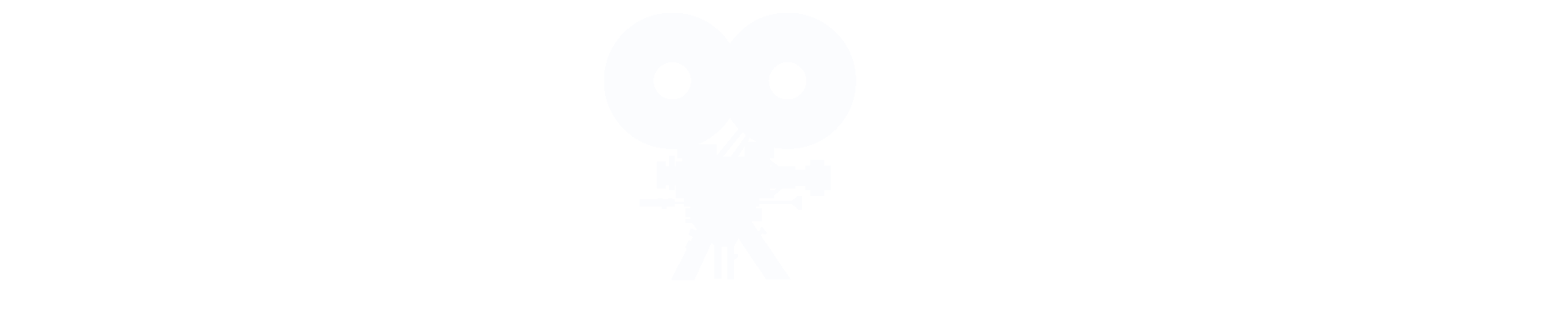Comment se reconstruire lorsqu’on a connu l’enfer ? La caméra de Guillaume Suon, pleine de pudeur, nous plonge au cœur de l’esclavagisme moderne, en allant à la rencontre de tous les maillons d’un business sans foi ni loi. Rencontre avec le réalisateur à l’occasion du FIFDH 2015.
A cause de la crise qui frappe leur pays, des milliers de Cambodgiennes travaillent aujourd’hui à l’étranger, souvent dans des conditions effroyables. Elles ont été appâtées par des passeurs cyniques, glaçants. Les victimes, quant à elles, reviennent détruites tant physiquement que psychologiquement. Parvenant à allier la modestie de son approche à l’urgence du problème, ce poignant documentaire ravive des notions de l’humain comme objet de transaction qu’on aimerait croire profondément enfouie.
– Comment est né ce projet ?
– Ce documentaire s’inscrit dans une logique de recherche sur le Cambodge qui est le pays de mes origines par ma mère. J’ai commencé à travailler sur le Cambodge il y a une dizaine d’années, dont six ans avec Rithy Panh. Cette recherche est un tout : d’abord une recherche sur l’histoire du pays pour expliquer son contexte, ses problématiques sociales, ce qui, après deux ou trois films m’a amené à me pencher sur des problèmes plus actuels comme celui de la migration des jeunes paysans cambodgiens. Cette thématique de la migration des paysans, qui était d’actualité dans le débat politique lors des élections l’année dernière (2014), regroupe d’autres sous-thématiques sociales qui sont très prégnantes : le vol des terres, le chômage, le problème de l’éducation, le problème de la distance entre la campagne et les villes et en toile de fond la mondialisation. Tout ceci crée une matière très riche à travailler en tant que documentariste. Pour moi, le film ne commença vraiment que lorsque j’ai rencontré Aya. J’ai co-signé l’enquête avec une jeune Cambodgienne, Phally Ngoeum, qui est devenue assistante sur le film et qui a également assuré la prise de son. C’est une production artisanale avec une équipe réduite, qui bénéficie d’une grande connaissance du terrain et des problèmes sociaux du Cambodge. Quand on a rencontré Aya, le film a pu commencer. C’est elle qui va incarner cette jeunesse à la dérive du Cambodge. Le trafiquant est là pour incarner une autre partie de cette société. Ce face à face, ce miroir esclave-bourreau était la base du film. A partir de ces éléments, de ces personnages, on a commencé le film.

– Comment s’est déroulée cette première rencontre avec Aya, et comment est-elle arrivée à libérer sa parole ?
– La première fois que l’on a vu Aya, on a passé plusieurs jours avec elle et sa mère, hors caméra, sans trop parler, à observer pour essayer de s’inscrire dans leur milieu, dans leur monde, en restant en retrait afin de ne pas perturber la fraîcheur de ce qui se passait. La préparation a été longue afin d’établir une relation de confiance. Aya, je la compare à un petit oiseau blessé, on doit lui faire comprendre que l’on n’est pas là pour lui faire du mal, que nous sommes là pour parler, que cela sera aussi bien pour elle d’aller libérer cette parole, qu’il y ait un film ou pas. A ce moment là nous sommes au-delà du film, parce qu’on est face à une personne qui souffre, son visage l’exprime. Là on se dit qu’est-ce que l’on peut faire ? S’approcher de cette personne et peut-être faire un film.
On a travaillé sur plusieurs semaines mais le tournage a duré plusieurs mois. On a multiplié les visites, une relation de confiance s’est établie, une relation de familiarité presque. Là on a commencé à sortir la caméra, à travailler tout doucement, dans une approche incluant la mère et toutes les personnes du film.
– Les paroles de la mère sont dures voire violentes vis-à-vis de sa fille (Aya est de retour de la Malaisie après avoir subi des violences et un viol) et de son petit-fils (issu du viol). Comment vivre sous cette pression ? Seuls les propos du père contrebalancent la violence des propos de sa femme : le père culpabilise d’avoir fait émigrer sa fille Aya.
– Le père travaille, c’est l’un des seuls de sa famille, et gagne un dollar par jour. Il est quasi-absent, il n’a donc pas de recul sur sa famille. En revanche, la mère est confrontée au quotidien, au regard des autres villageois, des autres enfants qui meurent de faim. Pour la mère, Aya l’aînée doit se sacrifier pour les autres enfants du village, mais Aya a échoué. Du point de vue de la mère, il y a de la colère, il n’y a pas de place pour la pitié. Peut-être Aya a-t-elle été maltraitée, abusée mais les autres enfants vont aussi payer le prix de cet « échec ». Le point de vue de la mère est très difficile à comprendre mais on est dans un système de survie. Cette mère a des propos très durs vis-à-vis de sa fille. C’est le cas aussi pour les migrants qui reviennent au Cambodge sans argent. Les parents sont souvent très durs avec eux parce que s’ils échouent, les conséquences vont retomber sur la famille. C’est impossible car les familles s’endettent pour envoyer un enfant émigrer. Tous les espoirs sont fondés sur lui. Les jeunes filles, quant à elles, ont une responsabilité énorme sur les épaules et elles en paient souvent le prix fort en migrant (maltraitance, viol…).

– La conséquence sociale est le rejet, le bannissement de cette famille du village.
– La famille d’Aya est pointée du doigt, les parents ont honte que leur fille ait échoué à l’étranger et n’ait pas réussi à élever le niveau social de la famille. Il y a des cas où les jeunes reviennent avec de l’argent, les familles s’interrogent donc sur l’échec de leurs enfants. C’est donc de leur faute ! « Pourquoi les autres réussissent ? ». « Ne dis pas qu’il est impossible de réussir ! C’est possible mais ce n’est pas ton cas. C’est de ta faute ! »
Les questions qui reviennent dans le village sont : « Ta fille est rentrée ? Que s’est-il passé ? » On n’en sort pas. Pour la mère s’ajoute à cela le problème de l’enfant, issu d’un viol qui, pour la grand-mère n’en est pas un, c’est de la prostitution. On est dans un système de survie : pas de place ni pour les sentiments, ni pour la pitié. C’est au jour le jour. On a un dollar par jour pour survivre, comment on fait pour s’en sortir avec ce dollar ? Il n’y plus de place pour l’individu.
– L’Etat est le grand absent dans votre documentaire. Comment celui-ci « manœuvre » entre cette nécessité économique d’avoir des migrants pour le pays et cet esclavage moderne ?
– L’Etat est absent, comme il l’est dans le documentaire. Il n’existe pas. Ce sont des réseaux criminels qui agissent, qui réduisent l’être humain à des marchandises qui rapportent beaucoup d’argent. Ces groupes sont très présents au Cambodge. Ils sont très difficiles à combattre car ils ont beaucoup d’argent. Ils sont très ingénieux pour falsifier les passeports et pour transporter des esclaves. Le gouvernement est impuissant. Récemment, il y a eu des réformes suite à l’accumulation de victimes qui rentrent au pays. Sur le terrain, rien n’est fait pour convaincre un jeune paysan qui meurt de faim afin d’éviter son départ et de tomber dans les mains des réseaux criminels.
Comment combattre ce phénomène ? Même à l’ONU on ne sait pas. Les lois sont floues. Elles ne sont déjà pas appliquées au niveau international, donc au Cambodge… Les réseaux criminels ont les mains libres pour amasser leur argent et s’étendre. On en parle dans les médias, personne n’ignore ce phénomène mais personne ne sait quoi faire, donc on laisse faire ! Cependant, le message diffusé par les médias est souvent peu efficace. Il n’a aucun impact sur la population.

– Le personnage de Pou Houy (un trafiquant d’être humain) est résolument haut en couleurs. Comment abordez-vous ce type de personnage ? Comment s’est effectuée la rencontre ?
– Ça a été assez simple de le rencontrer car, là où il y a des esclaves, il y a des trafiquants. Ils habitent à côté. La mise en esclavage se fait à partir d’une tromperie qui est exercée par un proche de la famille. C’est la confiance qui est trahie, une parole rassurante, même si ce n’est pas sûr qu’ils soient bernés, mais ils ont envie de tenter leur chance. Ils n’ont rien à perdre ! Ça fait donc de Pou Houy un personnage moins convaincant que l’on peut imaginer. Il y a une complexité énorme dans ce personnage. Il parle énormément, il veut montrer sa réussite. C’est aussi ça la société cambodgienne : peu importe comment on réussit, l’important c’est d’être puissant et de s’en sortir. Celui qui a tort ce n’est pas celui qui fait des choses illégales et qui mange, c’est celui qui meurt de faim.
Pou Houy est ancien pauvre, il sait ce que c’est que d’avoir faim. Il ne voudra jamais redevenir pauvre et fait tout ce qu’il peut pour maintenir son niveau de vie de nouveau riche. De nouveau riche sans âme, que Pou Houy vend à une nouvelle forme de chrétienté, souvent vu dans les pays du Quart Monde, « si vous avouez tous vos pêchés, vous êtes lavé de tous vos pêchés et vous allez au paradis ». C’est une religion qui arrange bien les criminels, comme les Khmers rouges, qui se sont convertis à plus de 90% dans cette branche de la chrétienté. Forcément, quand on massacre des êtres humains pendant des années, aller au paradis c’est un problème. A l’inverse, chez les bouddhistes le karma ne s’achète pas. Donc, si vous avez commis une mauvaise action cela va se répercuter sur votre vie d’après. Quand on est un criminel, on est coincé. Pour bien dormir, cette branche du christianisme arrange bien les choses. Les gens comme Pou Houy se rachètent ainsi une bonne conscience et une âme. Le simple fait de rentrer dans cette religion, montre qu’il se pose des questions sur ce qu’il fait.
– Pou Houy craint la déchéance sociale, il est donc prêt à tout ?
– Quand on a faim une fois et que l’on s’en sort on ne peut retomber… ce n’est pas possible ! C’est quelque chose qu’il ne pourra pas accepter et là il devient très dangereux parce qu’il fera tout pour s’en sortir. Il sera prêt à vendre tout le monde pour ne pas redevenir pauvre.
– Quelle est l’ampleur de cette immigration ?
– C’est une question que je pose à chaque fois que je rencontre une personne d’une institution internationale… et personne ne sait ! On parle de 200’000 migrants / esclaves. A la fin du tournage 300’000 cambodgiens, travaillant en Thaïlande, ont fui les répressions et sont retournés au pays. Ce retour en masse a fait exploser les chiffres « officiels ». Donc, on ne sait pas. Il y a un demi-million de migrants qui reviennent et qui ont été maltraités. Il y a des milliers d’Aya au Cambodge et le gouvernement ne prend pas assez ce problème au sérieux. Il ne se rend pas compte que la jeunesse est en train d’être sacrifiée. Cette jeunesse va devoir reconstruire son pays et elle en sera incapable.

– Quelles sont vos influences cinématographiques ? Vous abordez au plus près vos personnages afin de trouver une humanité dans chacun d’eux, même pour des personnes ambiguës comme Pou Houy.
– L’influence principale est bien sur celle de Rithy Panh (nda : qui est aussi présent au FIFDH pour présenter son documentaire « La France est notre patrie ».). C’est plus qu’un producteur, c’est une sorte de maître du documentaire qui partage son expérience, qui partage ses propres influences et qui encourage les travaux au long cours.
Ce documentaire représente trois ans de travail : se placer à la hauteur des personnes que l’on filme, ne pas céder à la facilité par respect pour elles, c’est révéler une humanité, c’est garder une distance juste, ne pas tomber dans le voyeurisme, ne pas faire des plans obscènes de la pauvreté, c’est filmer de façon juste une personne qui souffre. C’est très difficile, cela demande du temps, des sacrifices et de l’engagement. Par exemple, quand Aya va dans le lac pour chercher de la nourriture, je me dois d’aller dans le lac, avec elle, pour filmer. Le documentariste ne doit pas filmer de la berge, bien au chaud et filmer les gens comme dans un zoo. Ce n’est pas possible. Tout ce travail sur le corps à corps, sur l’humanité, sur le respect du personnage c’est quelque chose qui m’a été transmis par Rithy Panh. C’est une façon de faire du documentaire, peut-être l’une des plus difficile, mais qui pour moi est la plus respectueuse des personnes que l’on filme. On n’a pas le droit de vendre une histoire, on doit s’engager, être avec ces personnes et essayer de cadrer le plus juste possible.
– Cette confiance établie avec les personnes, permet de créer une proximité et une intimité avec elles…
– Si je ne vais pas dans le lac avec la personne que je filme, elle ne me parle pas de la même façon et, si je ne parle pas la même langue, si je ne m’adapte pas à leur environnement, si je ne dors pas avec eux, si je ne mange pas ce qu’ils mangent, ils me considèreront comme un étranger. Je suis étranger, mais je suis franco-cambodgien, même si sur mon visage cela ne se voit pas trop. Pour eux, je suis toujours le blanc qui parle khmer et qui mange comme eux. Cela a un petit côté sympathique qui permet d’être intégré dans un village et également de déjouer les pièges de la sécurité. On est obligés d’être intégrés au village, de comprendre les personnes, de rester sur place sur le long terme, ils doivent sentir du respect et de la confiance et seulement après le travail cinématographique commence. C’est un positionnement à la fois cinématographique, éthique, humain. C’est toute une façon de faire du documentaire qui ne s’invente pas. Rithy Panh n’a pas inventé ça mais c’est un courant qui semble le plus juste et qui est le plus difficile à suivre.

– Est-ce qu’une diffusion au Cambodge est prévue ?
– La réflexion est en cours mais on ne souhaite pas jeter de l’huile sur le feu dans un contexte difficile. Comment sortir ce film pour que le travail contre le trafic d’êtres humains soit efficace ? Comment ne pas froisser les autorités ? Comment ne pas attirer des problèmes à ces agences ? On ne fera pas seul cette diffusion, on souhaite s’appuyer sur les institutions, comme l’ONU, pour faire de la prévention. J’aimerais une diffusion dans les villages pour avoir les réactions des migrants. Je ne me fais pas d’illusion sur l’impact du documentaire : une personne qui a faim, va tout faire pour tenter sa chance. L’objectif est de susciter le débat, que d’autres personnes s’expriment afin de lever le voile sur la maltraitance. Avec ce documentaire, j’ouvre le débat sur un problème, le reste je ne sais pas faire : c’est aux institutions, aux gouvernements d’agir !
The Storm Makers : ceux qui amènent la tempête
Cambodge/France, 2014, 66’, vo khmer, st fr. Première suisse
Réalisation Guillaume Suon
Scénario Phally Ngoeum, Guillaume Suon
Image Guillaume Suon
Montage Barbara Bossuet
Production Bophana Production, Tipasa Production
Distributeur CAT&Docs