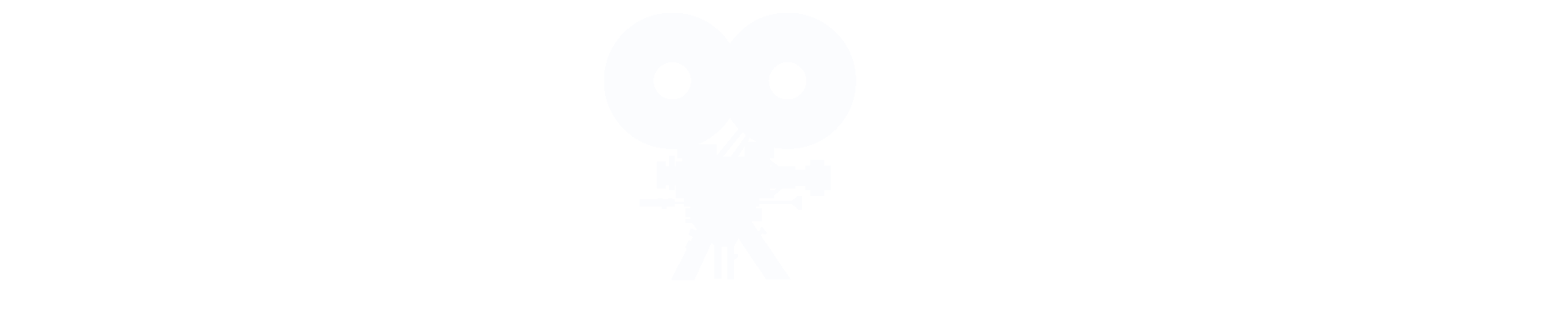Trois ans après Au revoir là-haut, le réalisateur de Bernie, du Créateur ou encore de 9 mois ferme revient avec une « tragédie burlesque » : Adieu les cons. Portée par Albert Dupontel, en quinquagénaire en plein burn out, Virginie Efira, en femme mourante, cherchant son enfant qu’elle a abandonné lorsqu’elle avait quinze ans, et Nicolas Marié, en archiviste aveugle, enthousiaste et volontaire, cette nouvelle aventure, aussi spectaculaire qu’improbable, conte les absurdités et les déviances de notre société numérique à travers un univers aussi décalé que poétique. Retour sur l’oeuvre avec Albert Dupontel.

D’où vous est venue l’idée de cette tragédie burlesque?
C’est un petit peu basique : il s’agissait de manier des concepts d’archétypes sociaux. Qu’est-ce qui se passerait si une femme, qui voudrait vivre, mais ne le peut plus, rencontre quelqu’un, qui peut vivre, mais ne le veut plus ? C’est un peu comme 9 mois ferme : qu’est-ce qui se passerait si une femme était enceinte d’un apparent psychopathe en train d’être jugé ? Ça commence comme ça. Ce petit pitch m’amuse bêtement. Ensuite, je commence à faire naître les personnages. Pour Adieu les cons, j’ai rajouté un personnage « brazilien », à savoir cet aveugle qui a été mis administrativement et de façon absurde aux archives. Je me disais : « est-ce que ça peut tenir la route »? En fait, ça ne tient pas si mal la route, notamment grâce à Nicolas Marié. Voilà comment les choses se mettent en place. C’est assez simple. La suite est plus laborieuse.
Pourquoi vous êtes-vous cette fois-ci tenu à un certain réalisme, notamment concernant les personnages qui me paraissent moins en marge de la société que dans vos autres films ?
Oui, c’est-à-dire qu’ils sont mis en marge par les évènements. Au départ, ils ne le sont pas. Du coup, l’idée est qu’ils soient beaucoup plus identifiables et donc beaucoup plus troublants. Quand je fais Bernie, Enfermé ou 9 mois, je me construis un personnage, une sorte de clown vaguement psychopathe, un petit peu décalé, et c’est très pratique ! Cela me permet de me mettre à distance de la réalité. Je peux raconter des choses que je ne pourrais pas raconter aussi facilement en étant moi-même. Sur celui-ci, surtout après Au revoir là-haut, l’audace c’était l’impudeur. À titre personnel, j’ai retiré ce nez rouge dont je n’ai plus vraiment besoin. Ça reviendra peut-être, mais pas tout de suite. Je me suis glissé dans une fable que j’imaginais beaucoup plus troublante que les autres. Ce sont finalement des envies qui génèrent à chaque fois le projet.

« Des personnes de notre pays qui sont des déracinés, des marginaux, des exclus, des laissés-pour-compte de toute sorte […] Il faut leur ouvrir les bras, c’est mon projet personnel » [ Bernie, 1996 ]. N’est-ce pas une réplique qui pourrait définir votre cinéma ?
Non, parce que ça fait vingt-cinq ans que je suis toléré. J’ai été bien accueilli, je suis bien aimé… Ils m’ont même filé des prix. Je suis professionnellement toléré, biologiquement en sursis. C’est pour ça que j’essaye de me dépêcher ! Je ne me souvenais plus de cette phrase ( rires ).
J’entendais plutôt que votre cinéma prend en charge et donne une voix aux petites gens, aux laissés-pour-compte.
Il n’y a pas que moi. J’ai toujours été sensible à une certaine littérature au cinéma : Chaplin, Ken Loach, dans un tout autre registre, les Monthy Python, qui racontent la folie des petites gens. En termes de littérature, j’adore Hugo. J’adore Simenon qui est vraiment le chantre des petites gens. Ça me plait ! Quelle est la meilleure façon de commenter le monde que je traverse si ce n’est à travers ces personnages-là ! Je les connais bien, j’en viens. Tout en étant un fils de bourgeois aisé… Mon père était médecin, mais venait d’un milieu très rustique. Autour de moi, ce n’était pas non plus des oligarques. J’avais conscience de mes origines, j’avais conscience de la chance que j’avais. J’avais conscience que c’est un endroit où on vit et où on ne prend pas de décisions. On les subit. Ces petites gens-là, ça me parait très intéressant d’en parler. Je les connais. Encore une fois, je n’allais pas bien loin : c’est ma tante, c’est mon père, c’est mon oncle, c’est mes cousins. C’est comme ça que ces petites gens m’intéressent. C’est mon fonds de commerce.
Un thème récurrent traverse vos films : la filiation et la maternité. Qu’est-ce qui vous inspire ou vous perturbe tant dans ce sujet ?
Ce n’est pas tellement un thème récurrent. C’est une névrose, une obsession. Je ne sais pas pourquoi. Comme je l’expliquais, je n’ai aucune raison, car je sors d’un milieu aisé. J’ai été choyé. Quand mon père a vu Bernie, il m’a dit : « qu’est-ce que je t’ai fait »? C’est vous dire… J’ai le sentiment que mes déviances d’adulte viennent beaucoup d’une certaine carence que j’ai eue étant enfant. Globalement, je pense que nos carences d’adulte viennent beaucoup de l’histoire que nous avons eue étant enfant. Même quand ça s’est bien passé, on a souvent des carences pédagogiques liées à une école qui se veut élitiste, mais qui est en fait surtout collectiviste. Elle néglige l’individu. Se rencontrer, c’est l’oeuvre d’une vie. C’est un motif fondamental pour moi. Quelque part, il justifie pas mal de choses que je fais dans mes films. J’ai trouvé un alibi intellectuel profond, émouvant et essentiel dans une vie. Ça m’autorise à prendre la parole et à parler de ces personnages-là. Voilà, c’est un peu mon raisonnement naïf qui me sert à raconter ces histoires et qui fait qu’elles sont effectivement un peu récurrentes.

Une chose m’a particulièrement interpellée dans votre film : le langage et la communication. Est-ce que le langage est devenu une chose symptomatique de notre époque et donc problématique dans nos relations ?
Pas forcément qu’au niveau du langage. Je trouve que nous sommes dans un monde hyper connecté. Seulement, on est sourds. Les gens sont côte à côte, mais tapotent sur leur tablette. Ils ne se parlent plus. Dans une administration, il y a tellement de gens qu’on ne sait plus qui fait quoi… Ils sont là six mois, un an, quinze jours. Ils partent. On ne connait plus les noms. C’est d’ailleurs illustré dans la rencontre entre Monsieur Kurtzman – encore un nom de Brazil – et le pauvre Monsieur Cuchas. Quand j’attaque le film, je ne me dis pas que je vais parler de telle ou telle chose. Ce n’est pas du tout le problème. J’invente des personnages, et je vois où ils vont m’amener. Bien souvent, ils m’amènent sur une trajectoire qui est le monde que vous connaissez. Et ce monde-là a les déviances que vous citez. Mais ce n’est pas ma première intention. Par contre, je vois bien dans le métro que tout le monde se passe devant, ne s’écoute pas et se concentre sur son iPhone. Dans la rue, pareil. Dans une entreprise, pareil. Le vieux geek est tellement dans son monde virtuel qu’il est complètement déconnecté de la réalité. En tous les cas, la dénonciation n’a jamais été mon propos. Vraiment pas.
La transformation du paysage urbain, l’hyperconnectivité et l’informatisation de la société semblent être des choses qui vous effraient et vous révoltent.
Ça m’effraie, et je le subis comme vous. Quand tout aura été construit, tout aura été détruit. Ce qui est intéressant avec la Covid, c’est que la nature est en train de nous dire : « arrêtez ! Je n’en peux plus ! La banquise fond. Vous bouffez des chauves souris. Etc ». L’intelligence collective, elle est là. Est-ce que les gens qui nous gouvernent tiennent compte de ces avertisseurs ? A priori pas. C’est ça qui est désolant, c’est ça qui fait douter. Autant j’ai une confiance en les petites gens, autant j’ai confiance en leur intelligence, leur bon sens, leur humanité, autant les élites me foutent une pétoche monstrueuse ! Ce qu’ils font, confinés parfois dans leur bêtise… Voilà. Adieu les cons, c’est en partie eux bien sûr. Mais c’est aussi nous. On a été dressés pour être des cons. On est cons, si on reste cons. Si on a conscience qu’on est cons, on a toutes les chances de s’en sortir. C’est peut-être ce qui va se passer avec la Covid : que les gens prennent en main leur vie et qu’ils commencent à protester contre ce que l’on veut faire d’eux. À savoir des consommateurs abrutis ou des bêtes de concours pour faire des dividendes dans une entreprise, etc. Encore une fois, j’enfonce des portes ouvertes, mais ces petites gens sont aussi là pour raconter ça.

Pour revenir à votre film, pourquoi avoir travaillé essentiellement sur fonds bleus ?
D’abord, j’ai un superviseur d’effets spéciaux, Cédric Fayolle, qui est un petit génie. Je bosse avec lui depuis quinze ans. Ensuite, ce n’est pas de sa faute, mais les choses se sont beaucoup démocratisées. J’ai donc accès plus facilement aux effets spéciaux avec des budgets raisonnables. Enfin, dans cette histoire narrativement improbable, mais émotionnellement cohérente, je ne voulais pas rater les émotions des acteurs. Mettre Virginie de nuit sur un parking bruyant avec du vent, voire de la pluie, je n’aurais pas eu les scènes de fin qu’on retrouve dans le film. J’ai recréé un univers. Si je ne le dis pas, personne ne devine que tout est faux. Personnellement, j’ai été vraiment détendu en travaillant. Je mettais l’énergie là où je voulais la mettre. J’ai trouvé des décors magnifiques – forcément, puisque c’est ceux qu’on a faits ( rires ). À l’arrivée, ce sont quasiment des dimensions urbaines, mais assez poétiques, notamment grâce aux couleurs que nous avons choisies.
Dès le départ, j’ai dit à Alexis Kavyrchine, qui fait la lumière avec moi, que je ne voulais pas du « clair-obscur », mais du « jour-nuit ». On travaillait avec des « diaph » très faibles. Un, cinq de « diaph » c’était largement suffisant pour nous. On avait aussi des nouveaux modèles de lampes qui s’appellent les « dodolight ». J’ai découvert le nom. Avant, on appelait ça les « mizar ». Je voulais faire des contre-jours et avoir une lumière très basse ; c’est plus expressif qu’une grande lumière. Des fois, j’étais battu, car j’étais en extérieur. C’est très contraignant, on ne peut pas faire grand-chose d’une lumière extérieure. Par contre quand on est à l’intérieur, on s’amuse comme des petits fous ! Les basses lumières, notamment au début, traduisent le confinement intérieur des personnages ; surtout celui du pauvre JB qui est intérieurement complètement éteint – sans qu’il le sache. Le travail de Cédric et Alexis permet de poétiser des décors urbains pas très jolis. C’est presque beau. Les ronds-points sont presque jolis, le parking est magnifique. Le double avantage de tout ceci se situe dans la maitrise du décor et dans la possibilité de mettre son énergie sur les émotions des acteurs les jours de tournage. Je referai pareil pour le prochain.
Vous êtes un réalisateur très fidèle à certains acteurs : Nicolas Marié, Philippe Uchan, Michel Vuillermoz, etc. Nouvelle arrivée, Virginie Efira. Était-ce une évidence pour vous de la voir dans le rôle de Suze Trappet ?
Ce n’est pas que je suis fidèle. Il n’y a aucune morale là-dedans. Ce sont de très bons acteurs. Nicolas Marié, Vuillermoz et Uchan sont des petits génies. Pour le coup, ce sont plus des artistes que des vedettes. C’est donc super de les avoir ! Ils sont à l’écoute. Ils ne sont jamais encombrés par eux-mêmes. Je peux vraiment travailler avec eux. J’abuse quand même de ces gens que je connais depuis plus de trente ans. Et puis ! J’ai fait venir une vedette. Virginie Efira. Ce qui m’intéressait chez la vedette, c’est la dimension artistique. Au début, elle n’était bizarrement pas en tête de liste. De loin. Seulement, elle a été épatante aux essais. On a des préjugés les uns sur les autres. On en a sur moi. J’en ai certainement sur les autres. Avec l’âge, j’essaye de m’en débarrasser. J’y arrive presque ! J’ai donc pris cinq actrices que j’aimais beaucoup. J’en ai rencontré d’abord dix. En fonction des dix, j’ai ensuite demandé à cinq d’entre elles si elles voulaient faire des essais pour moi. De grandes actrices ! Gentiment, elles ont accepté. Virginie, tournant beaucoup, n’était pas mon premier choix. Elle était pourtant épatante dans ce rôle-là. Elle avait toutes les notes que je cherchais dans cette gamme-là. C’était vraiment impressionnant. Ce côté sexy, ce côté populaire… Surtout cette dimension émotionnelle qu’elle a amenée dans son travail… Je ne sais pas d’où cela lui vient. Je ne me suis pas renseigné, je me suis contenté de la filmer.

Et Nicolas Marié dans le rôle de Monsieur Blin ?
Je voulais un personnage aveugle. Je cherchais un comble « brazilien ». Là, je suis vraiment dans la dramaturgie, je suis à distance du projet. Je me suis demandé ce que c’est le summum de l’absurde. C’est mettre un aveugle aux archives. Les administrations sont capables de le faire. Écrire sur ce bonhomme m’a fait rigoler. Le seul défaut que j’avais, ça a été de me dire qu’il me fallait un jeune. J’ai essayé. J’ai fait venir Grégoire ( Ludig ), David ( Marsais ), Kyan ( Khojandi ) pour ce rôle-là. Ce sont de jeunes acteurs que je vais retrouver dans mon prochain film. C’est sûr. Malheureusement, cela ne fonctionnait pas. Ça ne pouvait pas être eux, même s’ils ont beaucoup de talent. Je me suis rendu compte qu’un jeune aveugle, c’est plus triste que drôle. La tragédie s’exprime plus. J’ai donc sollicité mon copain Nicolas qui lui, par son âge mûr, apparait apparemment bénin. Il reste très vivace. C’est un acteur en très grande forme. Il est donc venu faire des essais à six semaines du tournage. Ça commençait à sentir la panique ! Il est toujours aussi épatant. J’ai retrouvé ce clown que j’adore en lui, et que j’ai exploité dans quasiment tous mes films. Tout ça pour vous dire que le casting est une vraie errance de ma part.
Nombreuses sont les références au film Brazil. Était-ce important pour vous de voir Terry Gillian apparaitre dans ce film, et de rendre hommage à Terry Jones ?
Quand j’étais enfant, ado et jeune adulte, ces gens ont énormément compté. J’ai eu la chance de les rencontrer. C’était impossible pour moi de ne pas faire quelque chose pour eux. Dans mon deuxième film, Terry Jones jouait le rôle de Dieu ( Le Créateur). Quand on a présenté le film à Londres, il est venu avec un copain. Terry Gillian. Le grand Terry – le metteur en scène de Brazil, film éminemment fondateur pour moi – a eu la gentillesse de me poser des questions sur la mise en scène du Créateur. La relation s’est ensuite maintenue pendant vingt ans. Terry est parti quelque part avec beaucoup d’élégance. Il a été malade. C’était une façon de nous dire « je vais disparaitre, mais doucement ». Il nous a prévenus. La dernière fois que je l’ai vu, c’était dans la salle de montage d’Au revoir là-haut. Terry Gillian, quant à lui, a lu mon scénario et m’a dit que mon histoire était aussi improbable que la réalité. Ça l’intéressait donc. Je lui ai demandé l’autorisation pour utiliser les noms de Kurtzman, Lint et Tuttle. Ils sont en direct ligne avec Brazil. D’ailleurs dans le film, il y a aussi un tout petit clin d’oeil avec un tuyau qui tombe. Dans Brazil, il y a un foisonnement de tuyaux qui tombent ! Il n’y a pas très longtemps, Terry a vu le film et m’a dit : « je te déteste ». Je prends ça pour un compliment ( rires ).

L’atmosphère et surtout les derniers moments du film m’ont emmené vers l’idée que vous pourriez envisager de vous tourner prochainement vers la dystopie.
La S.F., ce n’est pas vraiment mon truc. Je ne suis pas sûr que ce soit là où le cinéma français soit le meilleur. Le réalisme poétique à la Renoir, c’est un truc qui m’intéresse beaucoup. Dans Adieu les cons, il se trouve que mon héros est un geek hyper pointu en termes de technologie. D’ailleurs, on s’est fait encadrer par de vrais hackeurs. Ils n’ont même pas voulu inscrire leur nom au générique ! C’est pour vous dire ! Ils nous ont dit que la scène avec les ascenseurs était quelque chose qu’on pouvait faire sans problème – même si j’allais quand même un peu vite. Ils m’ont montré des choses complètement hallucinantes. Un de ces types a par exemple réussi à mettre des films pornos sur des écrans publicitaires dans une gare. C’était pour nous montrer que notre système est complètement défaillant. Bon, il a eu des petits soucis… En tous les cas, l’étendue de ce qu’ils peuvent faire est absolument ahurissante. Ils ont validé les interfaces que l’on trouve dans le film. « Quand tu pirates l’ascenseur, c’est ça qui va apparaitre », etc. Tout ça est possible !
Ce monde-là, je le subis comme vous. Il est peut-être bien. L’hyper connectivité va faire que des scientifiques du bout du monde vont enfin trouver un vaccin contre cette cochonnerie. Le pire est quand même qu’on est tous espionnés, tous azimuts. On est surveillés, surtout si on se prête au jeu ! Amazon, par exemple. Je n’aime pas Amazon, mais il faut reconnaître que c’est très pratique. Je gagne du temps. Il y a un tas de courses que je n’aime pas faire. En trois clics, j’ai mon PQ, j’ai mon eau de javel. Ils me font gagner un temps de vie au lieu de me le faire perdre dans la queue des magasins. C’est terrible ce que je dis ! C’est une réalité. Ce n’est cependant pas une multinationale intéressante. Elle incarne la destruction planétaire. Le principe est néanmoins bon. Je pense qu’on pourrait le garder et faire toutes ces choses dans des conditions plus écologiques. Voilà, ça me fait gagner du temps ; je peux bouquiner, je peux regarder des films, arroser des plantes, voir mes gamins pousser sans avoir à subir le stress des courses. Choses que personnellement, je déteste. Je ne dois pas être le seul… Surtout pour des tâches aussi domestiques que celles-là.

Pour le plus grand bonheur des spectateurs et spectatrices, vous n’avez jamais réalisé un film sans jouer dedans. Est-ce néanmoins une chose à laquelle vous pensez ?
Sur Au revoir là-haut, c’était le cas. C’était prévu que je ne le fasse pas. Ça devait être Bouli Lanners. C’est lui qui joue le médecin de Suze au début d’Adieu les cons. C’est un acteur et réalisateur belge très doué ! À deux mois du tournage, il m’a finalement dit qu’il ne pourrait pas. Je m’y suis donc collé, mais c’était un vrai bémol. Pour Adieu les cons, c’était plus une évidence, parce que je connais bien le personnage. Dans le prochain, je ne devrais normalement pas y être. En tout cas, pas pour le rôle principal. C’est un individu jeune, d’une quarantaine d’années, à qui il arrive des tas de choses. J’aimerais trouver l’acteur adéquat pour pouvoir tourné avec lui. J’en suis encore aux prémisses.
L’imaginaire et l’affection sont-ils pour vous les meilleurs vecteurs pour saisir et interpréter le réel ?
L’imaginaire est une bonne façon de comprendre le réel. Ou au moins de comprendre qu’il n’y a rien à comprendre. L’affection, c’est la meilleure façon de communiquer avec les gens. C’est la seule chose que l’on doit cultiver. L’affection de soi, modérément. Il ne faut pas tomber dans le narcisme. C’est le gros défaut de l’époque. On se « selfise », on raconte sa vie sur Facebook. Ça n’a aucun intérêt. Mais il faut quand même s’aimer un peu, et ne pas se mépriser. Surtout quand on quitte l’école. Relationnellement, il faut entretenir ça. Si tant est qu’il y ait un message dans Adieu les cons, c’est la difficulté de s’aimer dans un monde répressif et anxiogène.

Adieu les cons
FR – 2020 – 87 min
Tragédie burlesque
Réalisateur : Albert Dupontel
Scénario : Albert Dupontel
Avec : Albert Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan, Bastien Ughetto, etc.
Le 21.10.2020 au cinéma