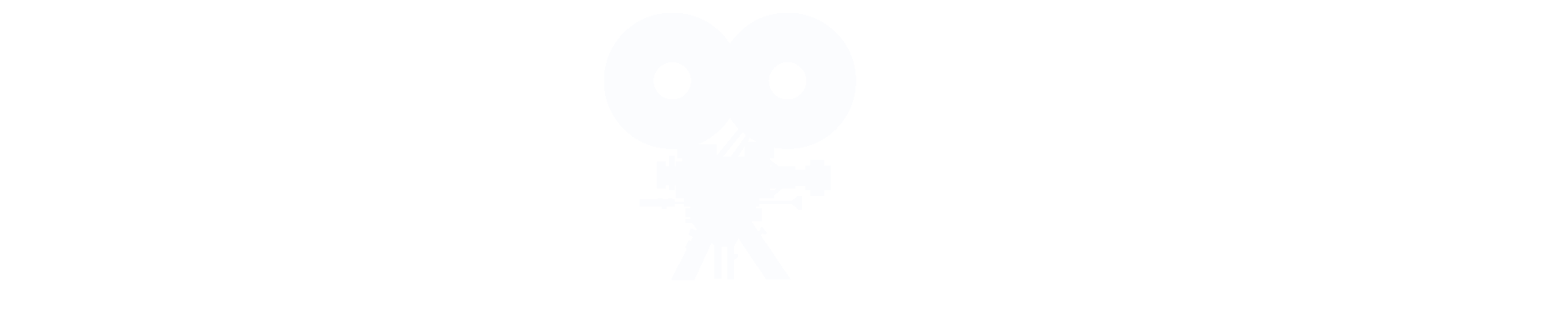Une semaine et demie, presque deux, un délai, une attente, une sentence. Voilà ce que peuvent représenter douze jours pour les patients hospitalisés sous contraintes dans l’hôpital psychiatrique du Vinatier de Lyon. Les malades internés ont le droit, dans ce temps de sursis, de comparaître devant un/e juge qui, en fonction d’observations réalisées par des médecins, prendra la décision de la poursuite de l’hospitalisation ou de la remise en « liberté » de la personne.
Vue et revue dans de nombreux films et sous des centaines de formes, la liberté est une des thématiques qu’il est intéressant d’aborder pour réfléchir, dénoncer, critiquer ; mais aborder la liberté dans le cadre d’un hôpital psychiatrique, cela engage d’autres perspectives et fait appel à des réalités différentes. Dans quelle mesure la personne est-elle un danger pour elle-même et pour les autres, les médecins comprennent-ils vraiment ce qu’il se passe dans la tête de cette personne, et surtout, qui sommes-nous pour juger de la capacité d’une personne à vivre en « liberté » ?
Depardon reprend donc cette fameuse thématique qu’il a déjà abordée de nombreuses fois. Il était déjà dans le cadre psychiatrique avec « San Clemente » (1980) et « Urgences » (1987), et s’attaquait à la justice dans « Délits flagrants » (1994) et « 10e chambre, instants d’audience » (2004). De la curiosité à l’incompréhension, le spectateur accompagne Depardon dans ses questionnements sur la conscience humaine, sur le système judiciaire, pénitencier et médical, qui tient entre ses mains, tous les jours, la vie de centaines de personnes saines, dangereuses, innocentes ou coupables. « San Clemente » s’ouvrait avec une remise en cause de la présence de la caméra au sein même de l’établissement abritant les malades, ce qui, avec beaucoup de regards caméra tout au long du film, plaçait le spectateur dans un position quelque peu voyeuriste. « Urgences » ressemble un peu plus à « 12 jours » tout du moins au niveau du dispositif, simple, qui filme le patient et le psychiatre face à lui, plutôt en les incluant dans le même plan ; cependant, le film de 2017 se caractérise par un cadrage qui isole beaucoup plus ses acteurs, avec un usage beaucoup plus prononcé du champ contre-champ qui place vraiment les deux partis face à face, abyssalement séparés. Les deux autres documentaires se rapprochent quant à eux plus de la captation de la réalité que d’une véritable prise de position de la part du réalisateur. Certes il y a dénonciation, mais elle n’est pas construite par le montage en tant que tel ; ce sont bien les accusés qui exposent les torts de tel ou tel système, qui revendiquent un droit à une justice qu’ils considèrent comme abusive et fausse.
Pour revenir à « 12 jours », trois caméras ont l’air d’avoir été posées là, dans la salle d’audience de l’hôpital ; une sur le patient, une sur le juge, une troisième pour des plans d’ensemble, ou pour ces quelques travellings languissants dans les couloirs de l’hôpital. Les regards se croisent, mais, jamais de contact à proprement parler, une distance de sécurité – ou de peur, de méfiance – s’impose entre la victime et son bourreau. Car c’est plutôt de cette manière que Depardon semble présenter la situation, une véritable situation de domination, de pouvoir, d’abus. Les patients ne sont pas, selon eux, en nécessité de prolonger leur hospitalisation, alors que la justice et le corps médical estiment le contraire. S’engage la bataille de la vérité contre la folie, réelle ou présumée. Depardon ne semble que peu s’aventurer sur le terrain de la réelle revendication politique, ce qui peut tout à fait être une démarche noble, certes, mais qui dans ce cas précis, alors qu’il enregistre du désespoir, de l’injustice, de la souffrance, de la violence, beaucoup de tristesse et de frustrations, fait tomber dans un drôle de voyeurisme sans discours critique, sans construction d’une distanciation par rapport au réel.
Alors que la thématique attise les curiosités et les questionnements du spectateur, elle ne semble pas être véritablement traitée sous tous les points de vue. Un regret se fait sentir dans cet espèce de huis-clos, duquel on ne sort que pour se trouver à nouveau enfermé dans d’autres barrières blanches quadrillées, d’autres barbelés prohibitifs, d’autres couloirs interminables. On est en cage, comme ce vieux monsieur qui fait des aller-retours dans un petit coin fermé en extérieur, avançant de trois mètre en trois mètre, à la même allure, avec la même attitude. C’est bien cela qui dérange : le film tourne en rond, au propre comme au figuré. La mise en scène est constamment la même, le montage présente en boucle le même type de séquence dans le même ordre, la décision du juge est toujours la même, la musique reproduit les mêmes séries de notes… Et pour les plans de lampadaire seul dans le brouillard, d’allée d’arbres s’effaçant à l’horizon au petit matin gris qui permettent de métaphoriser la solitude et l’incompréhension ressentie par les passants, on repassera au niveau de la subtilité. Le jeu sur les surcadrages et les motifs rectilignes, croisements de lignes verticales et horizontales, est moins kitsch, mais si volonté esthétique il y avait, elle n’est pas des plus transcendantes.
On ne demande évidemment pas à un film de traiter de manière « belle » ou joyeuse un sujet tel que celui auquel Depardon s’attaque, mais un manque de dynamisme, de prise de position concrète, et de volonté de faire changer les choses rendent le film moins fort, moins claquant, moins utile même. Reste encore à savoir si le documentaire doit toujours être porteur d’une utilité, d’une revendication, d’un message ou s’il se suffit à lui même dans sa qualité de captation du réel. Affaire à suivre.

FR – 2017 – 87 Min. – Documentary
Réalisateur: Raymond Depardon
Agora Films
13.12.2017 au cinéma