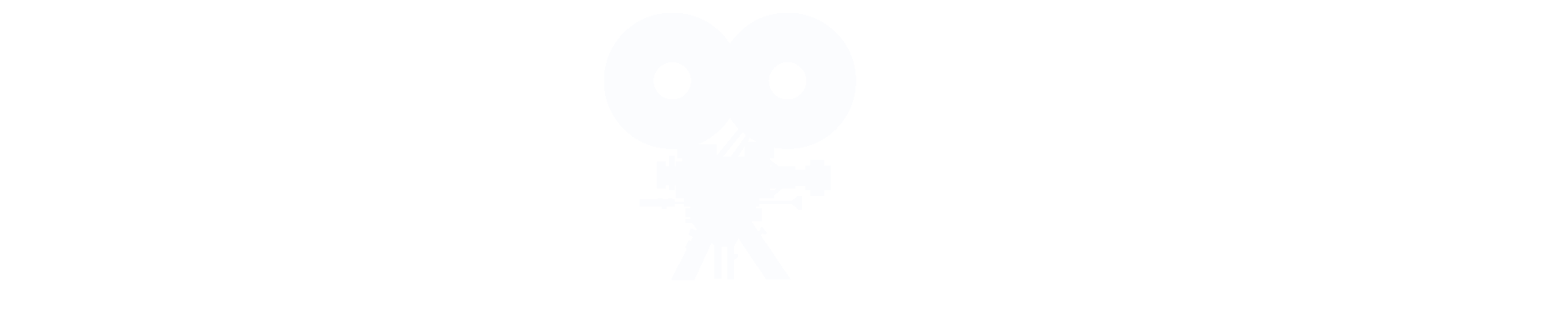Après Pedro Almodóvar et Clint Eastwood, la rédaction consacre sa Séance de rattrapage à Tim Burton!
Pour beaucoup de gens aujourd’hui, Tim Burton a perdu cette flamme, cette créativité qui animait ses débuts. On a beau chercher une cause à ce revirement, le fait est que le réalisateur a radicalement changé son approche du cinéma à l’aune des années 2000. Mais pour beaucoup, les premiers films de Tim Burton ont également été l’impulsion, le déclencheur d’une véritable passion cinéphilique.
Personne n’a traité le rapport à l’altérité comme lui, mettant au cœur de ses intrigues les marginaux, les bizarres et les victimes pour en faire de véritables figures héroïques. Il n’y a qu’à voir le culte qui entoure aujourd’hui des personnages comme Jack Skelington, Edward ou les méchants de son diptyque se déroulant à Gotham City. Avant d’être réalisateur, Tim Burton est un artiste qui peint ses personnages, les imagine, les projette. Il n’écrit pas, il habille ses univers. Torturés jusque dans leur chair, les personnages burtoniens sont devenus des icônes, des modes au fil des années.
C’est grâce à ses courts-métrages Vincent et Frankenweenie que Burton attise l’intérêt des studios. Évoluant au sein du studio Disney durant sa pire période économique et artistique (jusqu’à l’arrivée de Jeffrey Katzenberg), le jeune artiste peine à faire connaître son univers. C’est Stephen King, très sensible à ses talents, qui montrera Frankenweenie au studio Warner qui s’empressera de l’engager pour réaliser un film autour du personnage de Pee-Wee Herman. A seulement 27 ans, Tim Burton réalise donc le séminal Pee-Wee Big Adventure. La suite entre dans la légende, le réalisateur réussissant à casser la baraque au box-office avec des films foncièrement anti-commerciaux et éminemment personnels.
Sa patte visuelle deviendra, malheureusement pour certains, formule toute faite au fil des années. Quel que soit l’avis de chacun sur les films du monsieur, Tim Burton a su entretenir un rapport ambigu et paradoxal avec ses détracteurs et admirateurs. En cela, on ne peut nier la place prépondérante que celui-ci occupe dans l’industrie cinématographique d’aujourd’hui.
À l’occasion de la sortie de Big Eyes le 25 mars, les rédacteurs du Daily Movies se sont plongés dans la filmographie du cinéaste et ont découvert certains de ses films pour la première fois.
[Nathanaël Stoeri]
Beetlejuice, 1988
Tim Burton et moi, c’est un peu une histoire d’amour-haine. Étant complètement emballé par son univers décalé, j’adore son travail artistique et visuel. J’ai malheureusement été souvent déçu par le résultat final de ses films, en ressentant notamment une sorte de frustration en me disant « s’il avait été plus loin, ç’aurait été encore mieux ». Un seul exemple pour illustrer cela : Alice aux Pays des Merveilles. Je suis convaincu que si Disney n’avait pas mis son grain de sel, nous aurions peut-être eu droit à un chef-d’œuvre.
J’ai connu le réalisateur californien par le biais du très bon Sleepy Hollow. Depuis, j’ai pourtant une appréhension à chaque fois que je commence l’un de ses films. Parfois sans raison, comme pour l’agréable Sweeney Todd, ou alors en (pré-)connaissance de cause, à l’image de cet infâme Dark Shadows. C’est donc avec ce même sentiment que j’ai entrepris le visionnage de Beetlejuice.
L’histoire nous présente un couple qui vit dans une petite vie tranquille en campagne. Cependant, lors de leur première journée de vacances, ils subissent un accident de voiture – plutôt ridicule il faut l’admettre – et décèdent. Ils rentrent comme si de rien n’était chez eux et se rendent compte de la triste réalité. Parallèlement, leur maison est revendue et les nouveaux propriétaires s’apprêtent à emménager. Ils vont donc tout tenter pour les effrayer afin de les faire fuir, jusqu’à invoquer Beetlejuice, un être maléfique qui ne désire que sa liberté.
Le résultat final est un film dans la pure tradition de l’univers de Tim Burton. Selon moi, les personnages ne sont pas suffisamment explorés et il se dégage du long métrage un problème de ton. Nous sommes dans une comédie, dans laquelle les personnages ne semblent pas être choqués par des phénomènes surnaturels. En opposition à cela, on vise presque le malsain avec Beetlejuice, incarné magistralement par Michael Keaton (décidément), qui ne cherche qu’à coucher et se marier avec la jeune fille du couple. On jongle constamment entre drôlerie et malaise, mais on ressort frustré de ne pas voir plus souvent Beetlejuice – qui doit apparaître une vingtaine de minutes sur la totalité du film.
Je retombe donc sur ma pensée initiale : le long métrage était bien, drôle, dans un monde sympathique, mais « il aurait pu aller plus loin ». Ce n’est pas ce film qui va me faire détester définitivement le réalisateur, mais ce n’est pas non plus celui-là qui va me réconcilier avec son travail. Tim, notre histoire n’est pas finie !
[Robin Jaunin]
Ed Wood, 1994
J’admets volontiers qu’il m’est parfois difficile de croire que Tim Burton aime encore le cinéma. À en croire l’abondante succession d’auto-parodies qui forment le pan récent de son œuvre, la relation que Burton entretient avec son art semble progressivement prendre des allures de plus en plus ambiguës. En effet, si son débit ne s’est pas atténué, il ne paraît plus avoir la cote chez les critiques, l’audience perd patience, et chaque projet paraît marqué par un désintérêt croissant. C’est en ce dernier sens que le parallèle entre le protagoniste d’Ed Wood (1994) et son réalisateur atteint enfin sa limite, et c’est cette disparité qui m’a le plus frappé en visionnant le film en 2015.
Ce qui différencie Ed Wood d’autres biopics conventionnels réside dans la quasi-absence de l’aspect solennel et excessivement sérieux qui appesantit souvent ces derniers. Ed Wood, l’homme, est un éternel optimiste, un réalisateur qui, à défaut de disposer d’un réel talent, fait preuve d’assez de persévérance et de verve pour surmonter les innombrables obstacles qui se dressent sur son chemin. Il est évident que Burton se retrouve dans ce personnage loufoque qui ne peut s’empêcher de prendre sous son aile tous les autres marginaux qu’il trouve sur son chemin. Un Bela Lugosi sur la pente descendante, les veines noircies par la drogue, une curieuse femme fatale gothique et présentatrice télévision, un Bill Murray homosexuel et un catcheur inaudible de gravité, forment avec Ed Wood, lui-même un adepte du travestisme, le style de parias qui ont fait de Burton la caricature qu’il est aujourd’hui.
De Beetlejuice à Batman, d’Edward aux mains d’argent à Charlie et la Chocolaterie, la carrière entière de Burton joue sur l’archétype du raté inoffensif qui veut se faire une place dans le monde et le réalisateur s’est fait le garant de leurs succès. Sous l’égide du loser bienfaisant par excellence, un peuple entier de bonhommes saugrenus pourront briller malgré la différence, Ed Wood et Tim Burton, pour le coup, ne font qu’un. On ne s’étonne dès lors pas que Burton dépeint le périple de Wood avec tendresse, en lui substituant des notes d’optimisme là où une pointe de noirceur aurait paru plus adaptée. C’est que nous n’assistons pas uniquement à un biopic sur un réalisateur malaimé mais culte, mais également à la validation de toute une carrière. Si l’on approuve d’Ed Wood (et c’est difficile de faire autrement tel qu’il est présenté ici), on approuve de Burton.
Ce film m’a souvent été vendu comme la clé de voûte de la cathédrale gothique du réalisateur (si si, je me le permets), et c’est certainement le point de vue de nombreux critiques anglophones, malgré l’échec commercial du film. Ed Wood est sans aucun doute le fruit d’un amour évident pour le cinéma d’exploitation des années 1950 et pour cette personnalité atypique. La cinématographie est superbe, Johnny Depp excelle et je suis tombé amoureux de Patricia Arquette, mais si c’est là réellement le couronnement de sa carrière alors je veux proposer que c’est aussi la dernière fois qu’il a réellement émulé son personnage. La bonne réception du film garantissant le bien-fondé de sa démarche, Burton a pu se reposer sur ses lauriers en toute assurance, au grand dam de son audience dévouée. On me contestera certainement que de bons films ont suivi, mais sans doute difficilement que les rendements se sont faits décroissants.
[James Berclaz-Lewis]
Planet of the Apes, 2001
Grand fan de Tim Burton que je suis, imaginez le plaisir que j’ai eu à me proposer pour rattraper une œuvre de sa filmographie. Le choix ne fut pas trop difficile à faire puisque, ayant vu quasiment la totalité de ses longs métrages, il ne restait qu’à me décider entre Pee-Wee et La planète des singes. M’étant récemment attaqué aux deux derniers volets du reboot de la Fox, je me devais de rattraper la version revisitée de Burton (2001) du classique La planète des singes de Franklin Schaffner (1968). C’était sans savoir que j’aurai affaire au pire film du réalisateur américain, pensant avoir tout vu de lui après Alice au pays des Merveilles…
Ce que j’aime chez Burton, c’est cette identité affirmée, lui attirant autant d’éloges que de critiques. De Beetlejuice à Frankenweenie, en passant par Sleepy Hollow, Les Noces Funèbres ou Sweeney Todd, le réalisateur aborde toujours des thèmes universels avec une poésie sombre sublimée par des personnages très caricaturaux. Sa mise en scène rocambolesque, son écriture, ses décors, son humour amenant à chaque fois de la légèreté à la noirceur ; tout me plaît chez lui. Même ses défauts. Burton a cette particularité que peu de réalisateurs ont : Une inconstance très marquée. En effet, l’homme m’a autant habitué aux chefs-d’œuvre (Edward aux mains d’argent, Sweeney Todd, Big Fish) qu’aux films ratés (Alice aux pays des Merveilles, Dark Shadows).
A défaut d’être honteux, ce grand écart dans la qualité de ses films en est presque intéressant. Intéressant de voir les imperfections d’un réalisateur iconique tourmenté, de constater à quel point un metteur en scène peut à la fois nous émerveiller et nous dégouter, tout en prenant des risques sur des terrains différents. Ce sera peut être le cas de Big Eyes – sortie prévue le 25 mars – dont la bande annonce ne laisse que très peu entrevoir la patte Burton. Quoi qu’il en soit, l’heure est à La Planète des singes, d’autant plus symbolique puisqu’il entre parfaitement dans la catégorie des navets burtoniens qui s’écartent du style propre au réalisateur.
Dans un futur proche, des astronautes entrainent des singes afin de remplacer l’homme dans une mission exploratoire à haut risque. Le chimpanzé Pericles est alors envoyé dans l’espace mais la connexion avec son vaisseau va être subitement interrompue. Leo Davidson (Mark Wahlberg), entraineur du singe, désobéit alors à ses supérieurs et monte dans un autre engin pour le secourir. Tout comme Pericles, l’homme va perdre les commandes et s’écraser sur une drôle de planète où la race humaine est dominée par des singes.
Les primates de Burton ont toutes les caractéristiques humaines. Ils parlent, pensent, et ressentent des émotions. Les seules traits les rattachant au monde animal sont peut être les poils, leur nez, et leurs cris de singe quand ça leur chante. Le malaise est tout de suite là. Même si les maquillages sont irréprochables, on ne peut s’empêcher de voir un homme déguisé en animal par l’attitude des acteurs. Le casting des singes n’aide pas non plus – Tim Roth et Helena Bonham Carter sont ridicules – et les faux décors semblent être en carton. La caméra de Burton reste statique, trop concentrée sur le sol, n’allant pas plus haut que le tronc des arbres, enfermant alors le spectateur dans un vas-clos donnant l’impression d’être sur un plateau de tournage.
Difficile alors de se laisser embarquer dans un univers aussi peu crédible, d’autant plus que le visuel n’est pas le seul point faible du film. En effet, le scénario aux grosses ficelles passe son temps à rabâcher une morale simpliste sur la différence, le vivre ensemble, en montrant d’un doigt grossier que la haine attise la haine. Un sujet mainte fois exploité qui a tendance à lasser 14 ans après. L’histoire d’amour, à la fois prévisible et sortie de nulle part, entre Bonham-Carter et Wahlberg, rappelle une fois de plus le schéma Pocahontas ou Avatar. Ça y’est, le visionnage commence à être rude. La deuxième heure sera d’une lenteur insurmontable, devinant dès le début du film la façon dont il se finit, les humains essayant tant bien que mal de fuir les singes qui les poursuivent, sans aucun rebondissement. Grotesque. À croire que ce sont les adaptations qui portent malheur à notre cher réalisateur…
[Alexandre Caporal]
Big Fish, 2003
À la fin des années 1980, Tim Burton représentait un pur produit de fantasme pour les jeunes cinéphiles. En 1989, propulsé aux commandes de l’adaptation couteuse du Caped Crusader pour son troisième film, le cinéaste en devenir se retrouva du jour au lendemain sous les feux de la rampe avec l’étiquette de jeune prodige de la caméra (il avait alors à peine 30 ans). Ayant grandi à cette époque, j’ajoutai très vite le nom de Tim Burton à ma longue liste des cinéastes cultes dont il fallait voir absolument tous les films. Je me souviens très bien de cette journée de travail qui dura une éternité, pour la simple et bonne raison qu’il s’agissait du jour de sortie sur les écrans suisses de Batman et que le soir-même l’attente de plusieurs mois – à lire article sur article et à fantasmer devant les photos de tournage de la Batmobile, du costume new age de Batman, de Jack Nicholson en Joker et j’en passe – allait enfin prendre fin.
Toutefois, Tim Burton avait déjà frappé à ma porte et Beetlejuice usé mon magnétoscope flambant neuf à maintes reprises. Depuis, en bon cinéphile plutôt porté sur le fantastique et les pelloches barrées, Tim Burton devint un intime par écrans interposés, dont chaque film annoncé faisait monter la tension à une époque pas si lointaine où le mot Internet n’était pas encore courant… Pourtant, l’impensable finit bel et bien par arriver : le maestro commença à diviser public et critique une première fois avec Sleepy Hollow, très vite suivis par le remake de Planet of the Apes et le film qui nous intéresse aujourd’hui, Big Fish. Sans vraiment m’en apercevoir, Big Fish fut le film avec lequel je lâchai Tim Burton pour un moment. En lisant plusieurs critiques, il me semblait que le bon vieux Tim était docilement rentré dans les rangs hollywoodiens. La suite de sa carrière me donna (presque) raison. Je ne vis donc pas ce film au cinéma !
Plus de 10 ans après la sortie de Big Fish sur grand écran, à la recherche d’un film de Tim Burton que je n’avais encore jamais vu pour les besoins de cette Séance de rattrapage, le doute s’installa à nouveau : « Serais-je passé à côté d’un chef-d’œuvre ? ». Autre époque, autre format – le Blu-ray remplaçant désormais la VHS -, je me retrouve vite sur les genoux après 125 minutes de bonheur… Le constat : « Big Fish » n’est peut-être pas un chef-d’œuvre, mais un authentique cri d’amour au cinéma où l’on ressent à chaque séquence le lourd héritage du réalisateur envers ses propres parents. La décision de Burton de porter cette histoire à l’écran a été semble-t-il amplement renforcée par la perte coup sur coup de ses propres parents. Son père tout d’abord en 2000, suivi de sa mère en 2002, un mois avant la signature du contrat le liant à Big Fish. Très affecté par cette perte malgré le fait qu’il n’avait jamais été vraiment très proche de ses parents, Tim Burton a certainement vu le moyen de régler ses tourments personnels avec cette histoire rythmée entre drame émotionnel et récits extravagants.
Proche du conte de fée, la narration se déroule alternativement à travers le regard du père, qui invente les histoires les plus folles et celui du fils qui cherche à se détacher de ce père qu’il trouve trop envahissant. Plus à l’aise que jamais, Tim Burton déroule cette histoire touchante de manière fluide allant crescendo dans les émotions jusqu’à un climax dévastateur qui laissera peu de monde indifférent. Le cinéaste agence sa mise en scène autour d’une brochette d’excellents comédiens. Dans le rôle du père, Albert Finney est magistral et d’une finesse émotionnelle déchirante ; Ewan McGregor n’est pas en reste, interprétant le même personnage jeune, puisqu’il réussit une habile transition sur le jeu de Finney et rend ce personnage des plus crédible. Essentiellement centré sur la figure paternelle, les femmes ont néanmoins leur importance dans Big Fish. Ne cachons pas le plaisir de retrouver Jessica Lange, éblouissante dans le rôle de la mère, l’extravagante Helena Bonham Carter dans les habits de la sorcière ainsi que le jeu limité (mais qui prend tout son sens ici) de Marion Cotillard pas encore oscarisée !
Autour du cinéaste, l’équipe technique constituée de fidèles collaborateurs et de nouveaux venus réussit plusieurs tours de force visuels du plus bel effet (les séquences avec le géant, les scènes sous-marines, etc.). La photographie remarquable de Philippe Rousselot rend hommage à ce côté coloré cher au cinéaste. Pour rester fidèle au ton fantaisiste du mouvement littéraire Southern Gothic dont le film s’inspire, Tim Burton essaya le moins possible d’utiliser les effets spéciaux numériques, afin de renforcer le côté féérique et grotesque de l’ensemble. Enfin, fidèle collaborateur du cinéaste, Danny Elfman compose pour Big Fish une partition discrète et mélodieuse en parfaite adéquation avec les images.
Narrativement et visuellement très riche, Big Fish est une belle réussite, l’un des meilleurs films de Tim Burton et assurément son dernier grand film ! Maintenant que je l’ai découvert, j’ose encore considérer que Tim Burton n’est pas totalement perdu et j’en viens à espérer être surpris à la vision de Big Eyes. Cependant, le souvenir de cette journée de 1989, la tête pleine de rêves, me semble si loin, tout comme le cinéaste qui me faisait encore vibrer il y a quelques années…
[Jean-Yves Crettenand]
Frankenweenie, 2012
L’un de mes premiers souvenirs cinématographiques est lié à Tim Burton. En septembre 1989, initié par ma cousine cinéphile, je découvrais mon premier film sur grand écran. Pendant plus de deux heures, j’ai été immergé dans un univers atypique, à la fois sombre, poétique et par moments loufoque, où un homme déguisé en chauve-souris combattait la criminalité à l’aide de gadgets hi-tech et de la plus belle voiture qui existe. J’étais vraiment loin d’imaginer que j’avais visionné sur grand écran l’une des meilleures adaptations de comics, mariant parfaitement l’essence et l’esprit du matériel d’origine à l’univers propre d’un réalisateur, d’un auteur. Le cinéma de Burton allait atteindre son apogée l’année suivante avec le magnifique conte gothique Edward aux mains d’argent et surtout en 1992 lors du retour de Batman (Batman, le défi), véritable chef-d’œuvre du film de super-héros.
Malheureusement, les années 2000 ont été marquées par le déclin artistique du réalisateur de Beetlejuice. Sa popularité croissante et ses succès commerciaux étaient dès lors synonymes d’œuvres majoritairement formatées et impersonnelles, à quelques exceptions près (Big Fish). A chacun de ses nouveaux long-métrages, le réalisateur américain recyclait et vulgarisait ouvertement son univers visuel, avec la complicité d’un Johnny Depp plus intéressé par ses déguisements excentriques que par ses prestations. Ou comme le souligne élégamment l’actrice intemporelle Barbara Steele (Le Masque du démon), questionnée sur son rapport au cinéma de Burton lors d’une interview en 2011: « J’aime particulièrement ses premiers films… mais l’argent détruit tout ! ».
Deux ans après avoir touché le fond avec l’immonde Alice au Pays des Merveilles, Burton décide contre toute attente de revenir à ses premiers amours avec Frankenweenie, l’adaptation en long métrage de son second court homonyme datant de 1984. A l’image de son personnage principal faisant revenir son chien d’entre les morts, Tim Burton ressuscite le cinéma de ses premiers films au travers d’une déclaration d’amour aux classiques de la littérature fantastique, aux productions Hammer et tout particulièrement au Frankenstein de James Whale (1931) – autant d’influences qui ont bercé son enfance. Cet hommage se retrouve également au travers du design et surtout des noms des personnages. Avec Frankenweenie, le réalisateur américain revient au noir et blanc qui lui avait parfaitement réussi dans le touchant Ed Wood, mais aussi à la stop motion, technique déjà utilisée sur sa production L’Étrange Noël de M. Jack et sur sa co-réalisation Les Noces funèbres.
Ce long-métrage d’animation est une œuvre personnelle et sincère, traitant de l’amitié et d’un deuil impossible, directement inspirée de la relation du réalisateur de Mars Attacks! et du chien qu’il avait étant enfant. Le film contient donc de nombreux éléments autobiographiques. Un parallèle peut aisément être établi entre les expériences cinématographiques, la carrière de Tim Burton et les essais scientifiques de son personnage principal Victor au travers d’un dialogue inspiré avec son professeur. Ce dernier explique à Victor (Burton) que sa passion (le cinéma) doit venir du cœur et le questionne sur l’échec de sa deuxième expérience (deuxième partie de carrière). Véritable projection autobiographique de Burton, le protagoniste lui répond alors qu’il avait hâte d’en finir et qu’il l’avait fait pour les mauvaises raisons…
Avec Frankenweenie, Tim Burton livre une nouvelle fable gothique et mélancolique qui renoue avec la poésie de ses premières réalisations. Tout comme Big Fish, son dernier grand film, la réussite artistique de Frankenweenie ne serait-elle pas influencée par l’absence de Johnny Depp ?
[David Cagliesi]