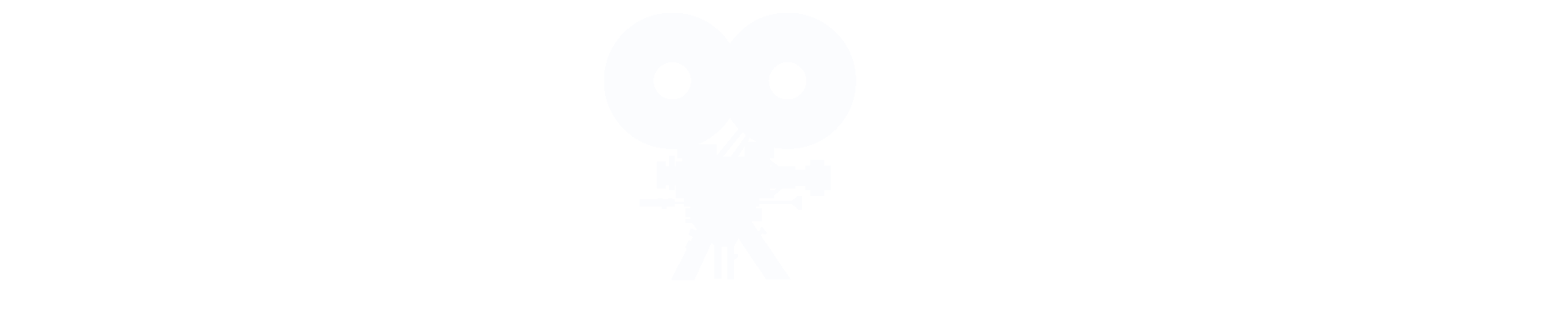Il n’y a pas que les ninjateries qui utilisent la ficelle du « 2-en-1 », c’est à dire le mélange honteux de deux films différents, une spécialité de chez la douteuse firme hongkongaise Filmark à laquelle les fans de nanars savent ce qu’ils doivent : il s’agit le plus souvent de quelques séquences tournées avec des acteurs occidentaux (ici les séquences avec Nick Reece, de son vrai nom Kent Wills) très largement complétées par (au moins) un métrage asiatique tourné quelques années auparavant, l’ensemble étant remonté et doublé à la volée pour tenter de parvenir à un semblant de cohérence. Quelques films d’horreur animaliers ont fait appelle à cette technique féconde en nanardise, comme ce « Crocodile Fury », dont en plus les doubleurs ont très clairement déconné pour la version française, probablement consternés par l’absurdité de l’ensemble.
L’HOMME QUI MURMURAIT A L’OREILLE DES CROCOS.
L’intrigue démarre dans un petit village thaïlandais, où les habitants se font dévorer les uns après les autres (et dans une ambiance globale d’anarchie complète) par un crocodile tantôt réel, tantôt en caoutchouc. Jack, villageois parmi tant d’autres, se détache de la masse en allant parler directement au crocodile. En effet, ce dernier n’est nul autre qu’une réincarnation de sa fiancée Maria (?!), tombée sous la férule du sage machiavélique Cooper et de son acolyte Don Moore.
Pendant ce temps, des mercenaires s’enfuient d’un champ, pourchassés par d’autres mercenaires. Tandis que le crocodile bouffe de plus en plus d’habitants, qui continuent à se baigner au mépris de tout danger, un mystérieux moustachu marche dans le désert, croise sur sa route un cadavre boursouflé, vomit trois fois d’affilée en gros plan avant de se faire attaquer par un crâne volant. Il est, semblerait-il, la cible des sortilèges de Monica, sorcière bien-aimée souhaitant conquérir le monde en s’alliant à Cooper et ses esprits / crocodiles, et en créant une race de vampires / zombies / mangeurs-recracheurs de poissons occasionnels montés sur ressorts (une figure récurrente du folklore horrifique chinois appelée « gyonsi »).
Sur ce, Bruce Thompson, dur à cuire en treillis, débarque non loin de là et se fait attaquer par un vampire de Monica après avoir essayé de convertir un bouddhiste au christianisme.
Sur ce, heureusement que le mentor de Jack, sosie troublant de Cooper, se lance à la moitié du film dans un succinct résumé des évènements, rappelant au passage que Cooper, dans son refuge maritime, s’est adjoint les services d’un nouvel esprit dénommé Steven. Ce dernier, probablement découragé par la chaos ambiant, provoque Don Moore en duel et succombe à ses assauts au bout d’un quart d’heure d’apparition à l’écran, alors que Jack renie Maria pour la belle Peggy, elle aussi forcée par Cooper de se transformer en crocodile afin de dévorer du villageois thaïlandais candide. C’est bon, vous suivez toujours ?
CLASSIQUE
Monceau d’absurdité tellement peu maîtrisée que c’en est effrayant, objet filmique monté en dépit de tout bon sens (les acteurs, à 70 % asiatiques, portent tous des prénoms américains, probablement pour faciliter l’exportation du film), invraisemblable et inépuisable vivier de répliques cultes à jamais (le résumé du mentor de Jack vaut son pesant de cacahouètes, ainsi que d’autres fleurons du genre, comme quand Jack, avec un sérieux imperturbable, prend le crocodile en caoutchouc dans ses bras avant de lui déclamer « Je comprends ce que tu ressens, mais tu ne peux pas continuer à massacrer tous mes amis innocents », et le crocodile d’acquiescer), « Crocodile Fury » est un véritable film-somme, qui se regarde en tant que tel dès son début fracassant. Reconstituer l’intégralité de l’intrigue est en soi un effort surhumain, une entreprise dont le sérieux est de toute façon sapé dès qu’on se remémore plus de cinq minutes du métrage.
Cette furie est un classique irrémédiable, à la glorieuse hauteur des incohérences Ed Woodiennes, du ringardisme forcené d’un Bruno Mattei, du manque putride de sensualité d’un Jean Rollin, ou du n’importe quoi limite rafraîchissant d’un Jean-Marie Pallardy. Assurément un grand cru.
[François Cau]